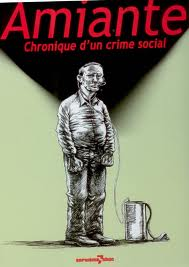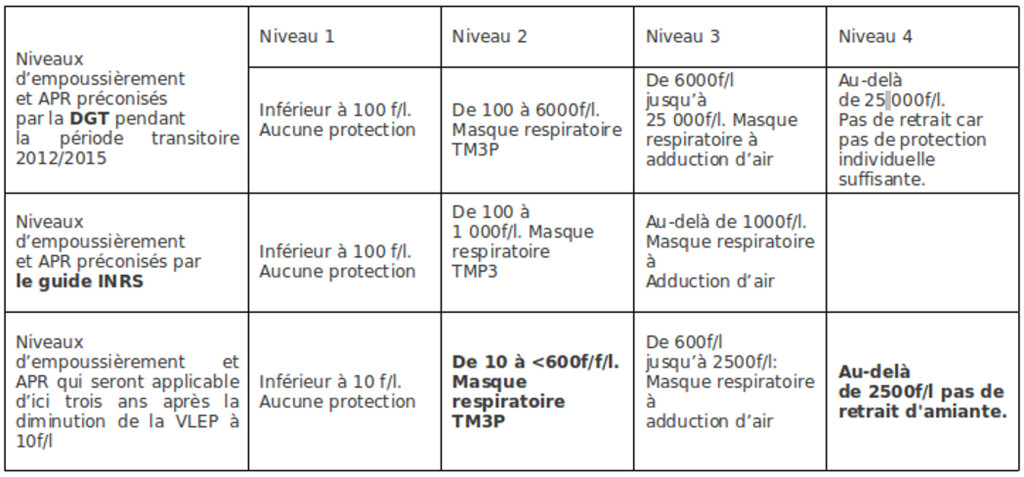La lutte c’est la santé !
Pour une politique de la souffrance
Dossier
« Rappelle-toi surtout, pendant ces années de souffrances
trop dures, de quoi tu souffrais le plus. Tu ne t’en rendais
peut-être pas bien compte, mais si tu réfléchis un moment,
tu sentiras que c’est vrai. Tu souffrais surtout parce
que lorsqu’on t’infligeait une humiliation, une injustice,
tu étais seul, désarmé, il n’y avait rien pour te défendre. »
Simone Weil, « Lettre ouverte à un syndiqué », La Condition ouvrière, 1951
« Car on ne peut accepter la vie qu’à la condition
d’être grand, de se sentir à l’origine des phénomènes,
tout au moins d’un certain nombre d’entre eux.
Sans puissance d’expansion, sans une certaine domination
sur les choses, la vie est indéfendable. »
Artaud, L’Ombilic des Limbes
Le thème de la souffrance au travail émerge dans le débat public français à la fin des années 1990. Auparavant volontiers marginalisé ou souffrant même d’un déni, il s’impose alors progressivement au point de devenir incontournable.
Dans le champ scientifique de nombreuses productions vont voir le jour et de nouvelles disciplines vont apparaître et s’affirmer en pensant à nouveaux frais une psychopathologie du travail. Dans le champ politique, le législateur va notamment consacrer la souffrance au travail comme préoccupation publique par l’inscription et la répression dans la loi du harcèlement au travail. Suivant ce mouvement les tribunaux se sont saisi du thème et ont développé une riche jurisprudence devant la multiplication des contentieux. La souffrance est désormais devenue un « risque » à part entière et l’évaluation et la prévention des risques telle que prévue par le Code du travail a intégré la santé mentale à côté des traditionnels risques physiques. À tel point qu’évaluer les dits « risques psychosociaux » est devenue une tarte à la crème de quasiment toute entreprise.
Doit-on en conclure que la souffrance au travail est désormais prise au sérieux et qu’un grand consensus national se serait imposé jusque dans les entreprises pour rechercher le bien-être des salariés ?
Rien n’est évidemment moins sûr… L’évocation, pour ne pas dire l’incantation, de la prise en charge des risques psychosociaux semble désormais relever d’une figure de style, passage obligé, supplément d’âme de la perpétuation de l’exploitation et de la domination. Car si le capitalisme a su intégrer le thème de la souffrance, il semble que ce soit précisément en en désamorçant la charge explosive qui aurait pu mettre en question les rapports de domination qui en sont constitutifs.
Ainsi, plus de 15 ans après l’émergence et l’installation du thème de la souffrance au travail, un sentiment mitigé voire de dépit semble gagner nombre d’acteurs et de professionnels amenés à rencontrer et prendre en charge la souffrance au travail. La souffrance n’a pour ainsi dire jamais disparu et ne semble même pas en voie de décrue tant l’intensification du travail et ses effets pathogènes semblent continuer envers et contre tout.
Comment comprendre et envisager cet échec au moins partiel ? La psychologie du travail a-t-elle manqué son objet ?
C’est partant de ce constat et des interrogations qu’il suscite que nous voudrions ici reprendre ce thème, non pour nier les importants apports théoriques des différents travaux en psychologie du travail dans la pensée de la souffrance ces dernières années, mais pour reposer la question de la souffrance comme question pleinement politique.
Intégrer la souffrance à la lutte
Sortir du déni
L’émergence de la souffrance au travail dans le débat public s’est initialement construite autour de deux livres en particulier ayant eu un grand retentissement à leur parution en 1998 : Le harcèlement moral de Marie-France Hirigoyen, et Souffrance en France de Christophe Dejours.
Le premier est centré autour de la figure du pervers narcissique. Ce faisant, l’ouvrage ne parle pas spécifiquement des situations de travail et de leur éventuel caractère pathogène mais se borne à constater la possibilité de l’expression de la personnalité perverse dans la sphère professionnelle. Un chapitre est alors consacré au travail et à la dégradation des relations de travail sous l’angle des conditions favorables à l’expression de la perversité ». Au rang de ces « conditions favorables », Marie-France Hirigoyen évoque tour à tour la menace du chômage, la concurrence acharnée entre salariés, l’augmentation des contraintes et l’intensification du travail qui en découle.
L’ouvrage semble néanmoins souffrir de la fermeture de son objet initial tout en cherchant dans le même temps à le dépasser. Évoquant dans un premier temps « l’entreprise qui laisse faire » le pervers, il développe ensuite son propos vers « l’entreprise qui encourage les méthodes perverses » et envisage l’éventualité d’un harcèlement managérial tout en n’employant pas expressément cette expression. Mais précisément s’agit-il encore de perversion quand on constate que l’organisation du travail produit une intensification du travail, une compétition entre salariés avec leurs corollaires de stress et de peur ? De plus si « le pouvoir constitue une arme terrible lorsqu’il est détenu par un individu (ou un système) pervers », pourquoi ne pas intégrer la subordination, constitutive de la relation de travail au sein de l’entreprise capitaliste, au rang des « conditions favorables » ? Reste que cet ouvrage a en son temps constitué un puissant révélateur de la dégradation des situations et des relations de travail. Il a également contribué à sortir nombre de « victimes » du sentiment de l’isolement en se reconnaissant dans les situations décrites. Signe de ce succès le pouvoir politique finira par introduire la notion de harcèlement moral dans la loi en 2002.
Autre est le projet de Christophe Dejours qui prend comme objet explicite de son analyse la souffrance au travail et le « consentement » à cette souffrance. Il s’agit là d’un « retournement épistémologique », retournement initié dans son ouvrage Travail, usure mentale (1990), qui redéfinit l’objet de la recherche en psychopathologie du travail, la souffrance au travail, comme « souffrance compatible avec la normalité ».
Ce faisant le projet est double : partir de la souffrance au travail comme ressort du consentement à la « banalisation du mal » à travers des « stratégies de défense » ; mais également comme point de départ d’une résistance possible. Pour ce faire il s’agit de commencer par sortir du déni. Le déni c’est d’abord celui des organisations politiques et syndicales. Dejours voit dans la désyndicalisation une cause mais aussi un effet de la tolérance à la souffrance d’autrui. Dans les années 70 l’influence d’un certain marxisme, qui a tôt fait de qualifier de « petit bourgeois » tout ce qui a trait à la subjectivité, a fait négliger la thématique de la souffrance eu travail. « Supposées antimatérialistes, ces préoccupations sur la santé mentale étaient suspectes de nuire à la mobilisation collective et à la conscience de classe ».
L’ouvrage fixe donc un cadre et un objectif : ne pas nier la souffrance subjective au travail et intégrer cette dimension à la lutte collective. Il faut pour cela relégitimer la parole sur la souffrance contre ceux qui la rangeraient au rang de la sensiblerie. À cet égard Dejours écrit de très belles pages sur l’usage de la virilité comme forme dévoyée du courage dans le travail. Le courage viril passe par l’apprentissage de la soumission volontaire et la capacité à infliger la souffrance à autrui. Il faut ainsi repenser un courage qui prend le risque de désobéir et d’être exclu de la communauté des forts et des virils en s’opposant à la banalité du mal.
Le projet initié est ainsi de promouvoir une véritable clinique5 du travail qui pense la personne en situation. Il va donner lieu à l’apparition de plusieurs disciplines telle la psychodynamique du travail chez Dejours mais aussi la clinique de l’activité chez Yves Clot.
Derrière la souffrance individuelle, le travail dégradé
Dans cette clinique du travail l’attention à la souffrance individuelle n’est pas une fin, elle doit d’abord nous permettre de retrouver et de réaffirmer le travail dans sa dimension collective. Derrière cette souffrance individuelle on retrouve un travail dégradé qu’on pourrait caractériser comme une « contrainte à mal travailler ». Être contraint de mal faire son travail, de le bâcler, de tricher même pour satisfaire un mensonge institutionnel sur fond de déni du réel est une source de souffrance majeure. Celle-ci s’est notamment développée du fait de l’intensification du travail observée ces dernières années ; intensification qui touche aussi bien les services, l’industrie que les administrations. On assiste notamment au retour d’un néofordisme dont le lean management n’est que le dernier avatar. Il faut souligner à cet égard le caractère peu original du lean management malgré le flot de novlangue qui entoure sa promotion. Il s’agit là encore du vieux projet totalitaire d’endiguer l’énergie, de capturer la pensée libre, de contrôler temps et mouvements pour se tenir dans le cadre institué. Les mêmes causes produisent les mêmes effets pathogènes…
Ce retour d’un néo-taylorisme est d’autant plus remarquable qu’il s’accompagne dans le même temps d’une injonction paradoxale à l’autonomie et à la prise de responsabilité. On valorise les « compétences » individuelles (au détriment des qualifications renvoyant à un statut) avec son corollaire d’entretiens individuels d’évaluation censés les mesurer et pour l’atteinte d’objectifs prédéfinis. Chacun est sommé d’être entrepreneur de sa vie et est renvoyé vers ses ressources
propres dans l’illusion d’une détermination de soi par soi… et en concurrence avec tous les autres. Et ce alors même que les travailleurs ne maîtrisent ni les moyens ni les objectifs de la production. Ainsi « à la prescription de l’activité du taylorisme et la dissociation du geste qu’il impose succèdent (s’ajoutent) aujourd’hui la prescription de la subjectivité et le déni de la contribution subjective des salariés à la vie des organisations ». Ce phénomène d’individualisation dans le travail détruit les collectifs, les capacités d’actions des syndicats en amenant de la désolidarisation généralisée.
De ce point de vue la prégnance de la référence au « stress » dans le monde du travail témoigne du décalage croissant entre l’augmentation des exigences et la réduction des ressources collectives mobilisables. La souffrance émerge alors d’un développement empêché, d’une amputation du pouvoir d’agir sur fond de collectif en miettes.
À cet égard on peut tenter de faire se rejoindre les travaux de Dejours en psychodynamique du travail et ceux de Clot en clinique de l’activité. Là où la psychodynamique du travail insiste sur le dysfonctionnement de la dynamique de reconnaissance par autrui comme facteur de souffrance, Clot va centrer son propos sur le pouvoir d’agir face à son éventuelle amputation. Ce dernier insiste en particulier sur la nécessité de prendre en compte l’activité empêchée comme dimension fondamentale du travail réel.
On peut néanmoins faire se rapprocher les deux perspectives à travers la question de l’identité au travail. Être reconnu c’est aussi en dernier recours et fondamentalement se reconnaître soi dans son propre travail. L’impossibilité du travail bien fait empêche cette reconnaissance. Le sujet ne peut se reconnaître dans le travail qu’on lui fait faire, l’activité perd son sens. Il est devenu comme étranger à sa propre vie. On retrouve ici la problématique classique de l’aliénation. Or le renoncement au travail bien fait, aux valeurs qui guident l’investissement dans une activité professionnelle a un coût psychique très lourd. « Quand la confrontation sur la qualité du travail est devenue impraticable, suractivité et sentiment d’insignifiance forment un mélange “psychosocial” explosif ». Des personnes qui souhaitent travailler dans les règles de l’art se heurtent à des conflits de critères qui renvoient à des conflits de valeur. Ces conflits de critères refoulés, parce que non discutés et non discutables, viennent s’enkyster dans le corps et la tête de chacun et la dégradation du travail vient dégrader la construction de sa propre identité au travail. Cette perte d’identité est personnelle mais aussi collective puisque les repères de métiers élaborés par le collectif de travail se trouvent disqualifiés. C’est sur fond de ce mélange morbide entre travail désaffecté et surinvestissement dans le travail que l’absence de reconnaissance par autrui, et au premier rang l’absence de reconnaissance managériale, devient la goûte d’eau qui fait déborder le vase.
Lutter contre ce travail pathogène ne signifie donc pas poursuivre, dans une fuite en avant, une reconnaissance hiérarchique foncièrement aléatoire et qui peut se retourner contre la qualité du travail lui-même. Il s’agit avant tout de retrouver du pouvoir d’agir sur son activité pour réenclencher une dynamique vertueuse de construction de son identité et d’accomplissement de soi. Au-delà, le travail permet au sujet de s’inscrire dans une histoire collective, celle de la réorganisation de la tâche par les collectifs professionnels, d’un travail d’organisation du collectif et de construction d’une identité professionnelle qui ne se confond pas avec le prescrit de l’organisation.
…repolitiser la souffrance au travail
Le risque persistant du psychologisme et la tarte à la crème des risques psycho-sociaux
L’apport majeur des travaux en clinique du travail est de sortir la question de la souffrance au travail du « psychologisme ». Par psychologisme j’entends une appréhension de la souffrance dans laquelle « les conflits sociaux peuvent être déplacés sur le plan des problèmes psychiques, autrement dit peuvent accabler l’individu sous la forme d’une affaire privée ».
Le développement spécifique d’une psychologie du travail est ainsi un apport indéniable d’un point de vue théorique en ce qu’elle permet d’analyser et de décrypter les ressorts d’une souffrance au travail par le travail ; elle est aussi un outil de résistance possible, notamment pour les syndicats qui se sont emparé à différents degrés du sujet. De ce point de vue la phase du déni initialement dénoncée par Dejours a été dépassée.
Reste à se pencher sur les résultats obtenus et les réactions institutionnelles. Disons le tout de suite, si l’on en croit les auteurs cités, les résultats ne sont pas reluisants. De fait dans la préface à la réédition de Souffrance en France, Christophe Dejours note que « dix ans plus tard […] la situation s’est aggravée, parce qu’aucune mesure n’a été prise en France ni à l’étranger pour favoriser, en matière d’organisation du travail, les choix qui pourraient être nettement moins délétères pour la santé mentale ». Même constat chez Yves Clot qui relève dans Le travail à cœur publié en 2010 que « selon les différentes enquêtes les Français sont très peu satisfaits, et même parmi les moins satisfaits du travail en Europe […] la situation française semble même se dégrader ».
Si l’on se situe du point de vue des mesures prises visant la répression de comportements pathogènes au travail, la thématique du harcèlement, comme nous l’avons déjà noté, a abouti au vote d’une loi le réprimant. Mais ce vote n’a pu se faire qu’à la faveur d’une double dépolitisation. D’une part au travers d’une reformulation légale des conflits professionnels en conflits interpersonnels ; d’autre part et corrélativement en éludant la question de la subordination. Tel qu’il est défini par le code du travail le harcèlement est aussi bien horizontal que vertical, descendant qu’ascendant. On trouve d’ailleurs régulièrement des employeurs ou des cadres pour nous expliquer qu’ils sont harcelés par leurs salariés ou des syndicalistes.
Certes il convient de moduler quelque peu le propos puisque le développement et l’évolution d’une jurisprudence sur le sujet a pu ponctuellement intégrer et condamner des formes de harcèlement managérial ; harcèlement managérial qui affirmait en creux la dimension collective du travail et la subordination juridique des salariés. Il n’en reste pas moins que la loi sur le harcèlement reste bornée par la problématique de départ qui l’a vue naître, à savoir une pathologisation du harcèlement dans la figure du pervers et une dichotomie pénale habituelle interpersonnelle : coupable/victime. Cette loi n’a à cet égard pas pleinement permis une sortie du psychologisme.
Qu’en est-il du côté de la prévention ?
On a vu tout d’abord se développer dans la sphère du travail des dispositifs de prise en charge de la souffrance sous l’angle traumatique. Ce modèle est une importation des différents dispositifs de prise en charge de la victime de type cellule d’écoute ou soutien psychologique. Initialement conçus pour les victimes de catastrophe, ces derniers ont peu à peu été intégrés à l’entreprise en guise de supplément d’âme du traitement de la souffrance au travail. Ils demeurent alors situés au niveau du traitement du symptôme et déconnectés d’une vision de transformation des situations de travail. « La lutte contre la souffrance au travail consiste en de l’orthopédie psychologique à visée adaptative qui réduit la subjectivité à un objet de prescriptions censée restaurer le “bien être” au travail ». Prévention dite tertiaire en ce qu’elle vise à traiter le malade afin de le réadapter en vue de son retour.
En amont d’un tel traitement des conséquences pour les salariés déjà en rupture un traitement des causes est préconisé dans le cadre d’une prévention primaire. La souffrance au travail est ainsi devenue un risque parmi d’autres à évaluer et à prévenir. Les risques psychosociaux prennent désormais place à côté des risques physiques (risque chimique, biologique, mécanique…). C’est ainsi que s’est développé un véritable marché du diagnostic et de l’expertise en risques psychosociaux à qui l’on sous-traite bien souvent l’analyse. Une fois le diagnostic réalisé, celui-ci est censé enclencher un plan d’action. Une telle affirmation pour évidente qu’elle paraisse ne l’est pourtant pas, tant pour beaucoup d’employeurs la réalisation dudit diagnostic tient lieu de plan d’action qui se suffirait à lui-même. Un plan d’action donc, oui, mais lequel ?
Les fameux « plan d’action » tournent la plupart du temps autour de deux types de mesure.
Tout d’abord des dispositifs qu’on pourrait qualifier de renforcement de l’individu, au même titre qu’un renforcement musculaire. Au-delà et en amont du traitement des traumatismes de salariés déjà en rupture, on a vu ainsi fleurir des stages de gestion du stress ou, pour les cadres essentiellement, des accompagnements de type « coaching » visant à un développement des ressources individuelles. Effet pervers de la psychologisation, il s’agit de rendre l’individu plus fort et plus performant en dissolvant la question du travail. Il n’y a pas alors à proprement parler de psychologie du travail mais des dispositifs d’accompagnement et d’adaptation de l’individu à la situation de travail. Détecter et prendre en charge les « fragiles » pour aider leur adaptation, on peut se demander si l’on est-on vraiment sorti du psychologisme avec ce type de prévention des « risques psychosociaux ».
Une autre approche, promue par la clinique de l’activité, consiste au contraire à centrer le débat sur le travail par la discussion autour des règles de métier. Il s’agit ici précisément d’éviter une approche hygiéniste des risques psychosociaux, qui transforme la fragilité des situations en fragilité des personnes. En d’autres termes il faut soigner le travail plutôt que l’individu, reconnecter « bien faire » et « bien être ». Ainsi, quelle que soit l’analyse de la situation de départ, en clinique de l’activité le plan d’action se termine toujours peu ou prou, par la préconisation d’une analyse des pratiques professionnelles autour de l’élaboration vivante des règles de métier entre pairs. Si l’objectif affiché est de retrouver une maîtrise sur sa situation de travail en développant collectivement son pouvoir d’agir, il n’en demeure pas moins que cette hypothétique maîtrise retrouvée reste fondamentalement limitée et temporaire.
Car, quand bien même la direction de l’entreprise accepterait de laisser place à ces temps d’échange en dehors du regard hiérarchique, il ne s’agit là que d’une suspension provisoire du lien de subordination. Sitôt le temps d’échange refermé le salarié retourne à sa situation de travail et aux rapports de pouvoir qui s’y jouent et à la subordination juridique qui le dépasse. L’éventuel pouvoir d’agir retrouvé se heurte à la structure inchangée et globalement inchangeable au dehors. Ainsi dans le meilleur des cas on a souvent l’impression que la montagne de la clinique de l’activité accouche de la souris d’une intéressante discussion entre collègues… avant que tout le monde retourne bosser. Cette situation et ce décalage est d’autant plus remarquable dans les grosses structures de type administration ou des groupes nationaux ou internationaux fonctionnant selon une gestion centralisée.
Face à un tel mur, le risque est une régression du collectif dans un collectif en quelque sorte décollectivisé qui se limite à l’interrelationnel et à des micro-discussions techniques sur les « bonnes pratiques ». Les contraintes liées à la structure globale, aux rapports de domination qui l’organisent, ne pouvant être prises en compte, le social tend à se réduire à de la sociabilité avec un groupe centré… sur le groupe. Et d’un objectif initial de travailler collectivement le travail pour le changer on glisse à une vision normative où il faut évoluer dans ses pensées, dans ses actions pour passer d’un moment où on ne se comprend pas, on ne s’aime pas, à un moment où le « groupe se termine bien », les gens ont évolué et sont plus ouverts à travailler ensemble afin, censément, de mieux vivre la situation de travail. Ainsi, en l’absence de remise en cause possible des structures du travail, ou à tout le moins de lutte en ce sens, on peut se demander si la psychologie du travail ne se retourne pas, là encore, en psychologie de l’adaptation.
On trouvera peut-être que nous sommes injustes avec la clinique de l’activité qui n’est, après tout, pas responsable de l’éventuel mur opposé par la direction des entreprises à toute visée de transformation du travail. Oui et non. Car au-delà des discussions entre pairs une telle approche, telle que conçue par Yves Clot, se propose de « gérer » et prétend dépasser le conflit d’intérêt inhérent à la relation salariale par ce type de dispositif. Pour Yves Clot « l’hostilité » dans les relations salariales en France relèverait selon lui de « l’inachèvement de son système de relations professionnelles », en effort collectif pour définir – à partir de, mais au-delà même de la relation salariale – les critères d’un travail propre, défendable, décent. » C’est ici que l’on ne peut plus suivre la clinique de l’activité telle que promue par Clot. Replacer la souffrance au travail au cœur d’une discussion collective entre pairs et hors présence hiérarchique est une chose, prétendre dépasser le conflit d’intérêt inhérent à la relation salariale par une discussion sur les critères de qualité du travail en est une autre qui relève au mieux d’une naïveté et participe dans tous les cas d’une dépolitisation de la question de la souffrance.
On risque ici de retrouver ce que j’appellerais le « syndrome de l’ergonome ». Là où l’ergonome prend toujours le risque de voir ses propositions d’améliorations techniques récupérées par les détenteurs des moyens de production pour supprimer du personnel et augmenter les cadences, le diagnostic en risques psychosociaux, même avec les meilleures intentions initiales du monde, voit toujours le risque d’être détourné en recettes en vue d’une meilleure adaptation de l’individu aux conditions de production.
Que peut-on en conclure ? Que faire ? La psychologie du travail n’est-elle au final qu’une psychologie de l’adaptation à la situation de travail ou constitue-t-elle malgré tout un nouveau levier de prise de conscience et de lutte pour la santé ?
La lutte collective c’est la santé !
Entre risque d’un retour au « déni » de la souffrance au nom d’une théorie révolutionnaire surplombante et psychologie de l’adaptation à la situation de travail, il nous paraît indispensable de repolitiser la question de la souffrance au travail.
Repolitiser la question de la souffrance au travail, c’est d’abord nommer le système dans lequel elle prend place et s’intensifie. Si, comme le dit Camus, mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde, la première chose à rappeler est que le travail dans notre société capitaliste est dans son immense majorité un travail salarié, basé sur la subordination. S’en tenir là est insuffisant, mais ne rien en dire est suspect et constitue le point aveugle de la psychologie du travail qui s’est développée ces vingt dernières années.
Le discours de Dejours à ce sujet est ambigu. S’il semble bien poser en arrière fond de la banalisation du mal ou de « l’injustice sociale » une logique systémique il paraît dans le même temps ne pas pouvoir ou vouloir l’assumer. Ainsi, évoquant le « progrès de l’injustice en régime libéral » il se refuse dans le même temps à y voir selon ses propres termes « le fait d’une logique endogène propre au système ». Ce faisant, Dejours s’embourbe dans des contradictions en faisant constamment implicitement référence au consentement à un système qu’il ne nomme ni ne définit jamais clairement tout en prenant soin de nier son existence17. L’illustration la plus flagrante de cet embarras sont les circonlocutions employées pour nommer
et éviter dans le même temps ce point aveugle. On pourrait à cet égard faire une compilation des expressions utilisées pour éviter de nommer ledit système : « régime libéral », « machinerie de guerre économique », « système néolibéral », « raison économique », « libéralisme sans entrave », etc. Le même embarras pourrait aisément être relevé chez Clot.
Ce que semblent redouter Dejours ou Clot par-dessus tout est le risque de la démobilisation dans une logique du « triompher ou périr ». Il faut pourtant sortir de cet entre-deux intenable du « ni résignation, ni dénonciation18 ». Si on ne peut que souscrire à un refus d’un « système » conçu comme « fatalité » imposant ses « lois naturelles » dans l’idéologie libérale, la logique même d’intensification du travail est d’une part consubstantielle au système capitaliste notamment dans sa logique d’accroissement constant de la plus-value relative pour parler en termes marxistes. D’autre part, la subordination constitue l’étayage du travail capitaliste. Il n’y a de management, et conséquemment de management pathogène, que sur fond de subordination juridique des salariés, constitutive du procès d’exploitation capitaliste. Nommer ainsi le système ou les logiques qui y sont à l’oeuvre ne signifie nullement les accepter ou se résigner devant l’ampleur de la tâche mais invite à reproblématiser la souffrance et à tracer une direction pour la lutte.
Pour ce faire il faut tout d’abord sortir la question de la souffrance d’une analyse en termes de « risques psychosociaux », tel un environnement toxique, pour la replacer du point de vue de la santé. Il convient ensuite de poursuivre les perspectives ouvertes par la clinique de l’activité sur le pouvoir d’agir pour le poser dans toute sa généralité et sa radicalité, c’est-à-dire en posant la question de la démocratie au travail.
La grille de lecture en termes de risques psychosociaux situe la souffrance à partir d’un risque extérieur « comme s’il s’agissait d’un nuage toxique planant au–dessus de l’entreprise […] qui atteint certains des salariés, en premier lieu bien sûr ceux dont les caractéristiques personnelles les fragilisent19 ». Une telle approche par « l’exposition » des salariés à un « risque » se développe en général dans un projet de le mesurer, la mesure étant la garantie de la « neutralité ».
Il faut renverser cette perspective, la souffrance n’est pas l’effet de l’exposition à un risque mais l’empêchement de la santé. Il convient ici de revenir un peu en arrière et de faire un détour par la pensée de la vie telle que l’a posée le philosophe Georges Canguilhem : la vie n’est ni ajustement à des normes, adaptation à des contraintes extérieures, ni l’infinie répétition du même. Elle est du côté de l’invention des normes, de la création. Ce faisant, la santé est cette capacité à créer et recréer ses propres normes, à agir sur mon environnement : « Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l’existence et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi ». Ainsi selon Canguilhem la santé réside dans l’activité normative d’interaction avec le milieu, et non dans une simple conformité « normale » à un milieu donné.
Comme on l’a vu la clinique de l’activité s’inscrit dans cette filiation en envisageant la santé au travail comme développement des possibles individuels et collectifs. Y. Clot développe le concept de pouvoir d’agir dans le cadre plus spécifique de la santé au travail entendu comme pouvoir d’agir sur le monde et sur soi-même, collectivement et individuellement : « il mesure le rayon d’action effectif du sujet ou des sujets dans leur milieu professionnel habituel, ce qu’on peut aussi appeler le rayonnement de l’activité, son pouvoir de recréation ». Il s’agit au sens propre d’une démarche d’autonomie. A contrario la perte de sens de l’activité par l’hétéronomie du travail la dévitalise, la désaffecte. On est alors en activité sans se sentir actif.
Or, encore faut-il que cette activité d’élaboration collective du travail soit possible c’est-à-dire tout simplement permise. Car qu’est-ce que penser la possibilité de création et recréation des normes d’activité par le collectif et pour le collectif si ce n’est poser la question pleinement politique de la démocratie ?
Les discussions autour des règles de métier ou de l’identité professionnelle censées développer le pouvoir d’agir, comme le promeut la clinique de l’activité, s’inscrivent dans un système organisationnel déjà là. Or, l’organisation n’est pas un simple collectif horizontal : « la notion d’organisation désigne un ensemble structuré de rôles, de rapports de pouvoir, de normes, établi pour répondre à des objectifs de production de biens et de services. Elle recouvre dans cette conception, une série de contraintes et d’obligations avec lesquelles les membres de l’organisation composent pour s’y construire une place et éventuellement en tirer bénéfice » Dans ce cadre assumer le conflit pour définir le « travail bien fait », ce n’est pas seulement confronter et assumer des controverses autour des règles de métier entre pairs, c’est aussi s’affronter aux objectifs de la production définis par l’organisation.
Ainsi sortir d’une vision de la santé comme adaptation au contexte pour une entrée par la qualité du travail qui cherche à créer du contexte rejoint inévitablement la question démocratique dans un monde, celui de l’entreprise, qui en est la négation. Car discuter collectivement du travail et de ses normes c’est déjà commencer à se le réapproprier et donc déposséder ceux qui en sont les détenteurs et ont vocation à décider. Développer l’autonomie c’est développer l’autonomie contre l’hétéronomie de l’organisation. La mise en discussion collective des normes de production est en soi un travail d’institution dans et au-delà des institutions actuelles. Autant dire qu’un tel processus est une lutte et un rapport de force sauf à vouloir à tout prix euphémiser la violence des rapports de production dans le travail capitaliste. C’est ici que le silence de la clinique de l’activité est assourdissant, comme si elle n’osait pas aller au bout de ses propres intuitions.
Pourtant si l’on prend au sérieux ce processus, c’est-à-dire qu’on ne le réduit à une anodine discussion entre pairs, il s’agit bien d’un processus d’auto-institution de la société au sens où Castoriadis emploi cette expression : « la culmination de ce processus est le projet d’instauration d’une société autonome : à savoir une société capable de s’auto-instituer explicitement, donc de mettre en question ses institutions déjà données, sa représentation du monde déjà établie. Autant dire : d’une société qui, tout en vivant sous des lois et sachant qu’elle ne peut vivre sans loi, ne s’asservit pas à ses propres lois ; d’une société donc, dans laquelle la question : quelle est la loi juste ? reste toujours ouverte ».
Dire cela n’est pas se résoudre à la résignation en attendant une hypothétique socialisation des moyens de production et l’avènement d’une société entièrement démocratique par un acte héroïque. C’est au contraire fixer comme perspective de lutte contre la souffrance d’engager d’ores et déjà ce processus de réappropriation. Le travail dès lors qu’il est collectif peut impliquer un espace de subversion des ordres pour produire des règles qui peuvent être mises au service de l’émancipation. Il s’agit de créer et de multiplier les espaces de réappropriation collective du travail avec en ligne de mire la réappropriation de la totalité de l’espace collectif, donc politique, de la production. Le premier plan d’action reste donc l’action et la résistance collective qui se réapproprie le travail, autant que faire se peut, ici et maintenant. Car « une organisation peut aussi se définir comme une mise en commun de ressources individuelles pour permettre la réalisation d’une action collective ».
Là encore nous retrouvons une inspiration de Castoriadis pour qui le collectif est « à la fois un regroupement de production et de lutte. C’est parce qu’ils ont à résoudre en commun des problèmes d’organisation de leur travail, dont les divers aspects se commandent réciproquement, que les ouvriers forment obligatoirement des collectivités élémentaires qui ne sont mentionnées dans l’organigramme d’aucune entreprise. C’est parce que leur situation dans la production crée entre eux une communauté d’intérêts, d’attitudes et d’objectifs s’opposant irrémédiablement à ceux de la direction que les ouvriers s’associent spontanément, au niveau le plus élémentaire, pour résister, se défendre, lutter».
Dans cette perspective l’expertise n’a de sens que si elle est partie intégrante d’un rapport de force. Plus, c’est dire que l’expertise doit elle-même abandonner sa « neutralité », c’est-à-dire sa position experte en surplomb, pour être co-construite avec et pour les salariés en lutte. Sans cela elle sera inévitablement rattrapée par le double écueil qui la guette en permanence entre impuissance et outil de gestion des ressources humaines. À l’inverse de la sous-traitance de l’expertise qui externalise la gestion des risques psychologiques, elle doit également être réappropriée comme savoir collectif.
Il nous paraît donc indispensable de partir de la souffrance… pour mieux la dépasser. La souffrance n’a pas sa valeur en elle-même, elle peut en revanche être principe d’action. Si le déni la concernant participe de la banalisation du mal, on ne peut s’en tenir au compassionnel sous peine de susciter une médicalisation du social par le soin apporté aux plus « fragiles ». Reconnaître sa souffrance, reconnaître celle des autres, doit amener la constitution et la prise de conscience d’un sujet collectif. Elle reste néanmoins une expérience sociale négative infra-politique si elle ne permet pas de poser à nouveaux frais la question de la santé au travail. Il s’agira d’éliminer le négatif par la chasse aux risques psychosociaux, nouvelle extension du domaine des ressources humaines, soustraitée au marché d’une psychologie du travail. Si la gestion des ressources humaines n’est pas assez diligente dans ce domaine il sera alors fait appel aux autorités publiques. Toutes interventions qui laisseront bien sûr intactes le pouvoir de direction des employeurs, l’exploitation et la domination du travail par ceux qui détiennent les moyens de production.
Pourtant derrière, ou malgré la souffrance, les travailleurs résistent, continuent à travailler, à faire valoir d’autres critères. Or, c’est précisément ici que la plainte peut devenir savoir et se politiser. Lutter contre le travail pathogène ce n’est pas limiter l’exposition aux risques psychosociaux, c’est se réapproprier le travail et le maintenir collectivement en débat, c’est-à-dire maintenir cette réappropriation vivante. La politisation de la souffrance passe ainsi par la restauration du pouvoir d’agir des collectifs de travail, cette restauration étant elle-même condition du développement de la santé, au-delà la souffrance. C’est qu’ici la santé est plus que l’absence de trouble, elle est force vitale, capacité à agir sur son environnement et non adaptation à celui-ci. Un tel projet est en soi une promesse de subversion de l’ordre capitaliste et de l’hétéronomie qui le constitue. Le contrôle de l’ouvrier sur ses oeuvres et la revendication de l’autonomie ouvrière retrouvent ici une nouvelle jeunesse.
Gilles Gourc
(article paru initialement dans le n°38 de la revue Refractions)