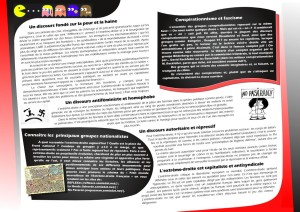Le Syndicats des avocats de France a publié une série de vidéos de décryptage du projet de loi Travail, les voici :
Catégorie : Réflexions
Un projet de loi, c’est un énorme pavé peu appétissant et plein d’arêtes. La Loi Travail, ou Loi El Khomri, ne fait pas exception. Mais comme elle constitue un danger si on l’avale, des militants de la CNT ont sorti les ustensiles pour vous en lever les filets. Même après des efforts de présentation, ça fait pas envie…
Si la vidéo ne s’affiche pas, vous pouvez utiliser le lien suivant : https://www.facebook.com/190533037645645/videos/1131461393552800/
https://player.vimeo.com/video/160982167
Le projet de loi El Khomri est une insulte au monde du travail. Rarement l’attaque aura été aussi grave. Avec l’inversion de la hiérarchie des normes qui permet aux accords locaux au rabais, obtenus sous la pression, de se substituer aux accords de branche ; en lançant l’offensive contre l’outil syndical avec la promotion des référendums-bidons en entreprise ; en organisant et généralisant la précarité, la flexibilité et en facilitant les licenciements, c’est une dégradation majeure du temps et des conditions de travail de millions de salarié.e.s que prépare activement le gouvernement.
À nous de nous préparer tout aussi activement à l’en empêcher ! Tout ce que mérite un tel projet c’est une riposte déterminée et massive des travailleuses, des travailleurs et de la jeunesse. Et pour cela, c’est le blocage de l’économie qui est à l’ordre du jour.
Le 9 mars, nous étions des centaines de milliers à battre le pavé. Pour nombre de salarié.e.s qui composaient la majorité des cortèges, la grève s’imposait. Et depuis le 17 mars, journée nationale de mobilisation appelée par les organisations de jeunesse, des dates de grève dans différents secteurs professionnels sont annoncées ; le 24 mars, nouvelle journée de mobilisation, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres, avec sans doute quelques effets d’annonces destinés à faire croire que la copie a été revue : nous le disons tout net, le projet de loi n’est ni amendable, ni négociable et seul son retrait, total, s’impose.
Enfin le 31 mars, la grève interprofessionnelle est à l’ordre du jour. Cette grève doit être activement préparée et nous pouvons profiter pour ça du calendrier d’action qui se dessine jusque-là pour renforcer la mobilisation. La seule manière de gagner et de faire plier le gouvernement, c’est de bloquer l’économie. Les travailleurs et les travailleuses doivent en effet prendre leurs affaires en mains dans cette lutte et ne doivent pas s’en remettre à des politiciens ou politiciennes qui n’ont que les élections de 2017 en vue. Et pour bloquer l’économie, ce qu’il faut c’est d’abord réussir la grève du 31 mars et préparer sa généralisation et sa reconduction partout où c’est possible dans les jours et semaines qui suivront !
Alors nous obtiendrons le retrait du projet de loi El Khomri. Alors nous pourrons préparer la contre-offensive, NOTRE contre-offensive en popularisant des revendications qui permettent de rassembler, sur lesquelles les équipes syndicales pourraient s’engager ensemble, à la base et dans l’unité. La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine, sans réduction de salaires, ni flexibilité, sans arnaque à la clef comme l’ont été dans de nombreux secteurs les « 35 heures-Aubry », voilà par exemple ce qu’il est urgent de mettre en avant pour contrer les dégradations des conditions de travail et imposer des créations d’emplois.
Tout cela, nous nous engageons à le mettre en débat auprès de nos collègues, dans nos structures syndicales, dans les intersyndicales auxquelles nous participons. Nous sommes certain.e.s que ces préoccupations, nombreuses et nombreux sont les syndicalistes qui les partagent. Quelles que soient les appartenances syndicales, nous les appelons à rejoindre cet appel, à en proposer la signature à leur structure syndicale et à mutualiser les informations sur la mobilisation sur le blog lié à cet appel. C’est toutes et tous ensemble qu’on va lutter, c’est toutes et tous ensemble qu’on va gagner !
Pour en savoir plus et signer l’appel : http://onbloquetout.org
Les 100 premier-e-s signataires : Christian Agon (CGT IBM), Eric Amy (CNT Boulanger Hénin Beaumont) Sylvain Apostolo (syndicaliste de la Confédération Paysanne), Enaut Aramendi (LAB), François-Xavier Arouls (Solidaires Groupe RATP), Christine Avenel (CGT Territoriaux Saint-Brieuc), Dominique Bacha (SUD/Sifp Territoriaux du Gard), William Battault (Cheminot CGT Malesherbes), Jérémy Berthuin-Uhl (Solidaires Gard), Claire Bidon (Solidaires étudiant-e-s Paris 8), Dominique Blanch (SNUipp-FSU Aude), Dominique Blivet (SUD Rural Territoires), Nathalie Bonnet (Fédération SUD Rail), Antoine Boulangé (CGT enseignement privé Créteil), Cindy Briguet (CNT Santé-Social CT Lorraine), Martial Chappet (Solidaires Paris), Antoine Chauvel (SNUipp-FSU 72), Nara Cladera (UL Solidaires Comminges), Marie-Anne Clément (CGT éduc’action 41), Philippe Colon (CNT garages Renault groupe GGBA), Quentin Dauphiné (FSU), Cybèle David (SUD éducation 93), Stéphane Degl’innocenti (SUD hôpitaux de Saint-Denis), Laurent Degousée (SUD Commerce), Fabien Delmotte (CNT-Solidarité ouvrière), Etienne Deschamps (CNT-Solidarité ouvrière), Jean-Marc Destruhaut (CGT AXA), Emilie Devriendt (Snesup-FSU), Gaëlle Differ (Fédération SUD PTT), Dominique Dubreuil (CGT retraitée Inspection du travail), Bertrand Dumont (Solidaires Groupe RATP), Jean-Luc Dupriez (UL CGT Carquefou), Peggy Durlin (SUD Crédit Agricole Mutuel), Simon Duteil (UL SUD/Solidaires Saint-Denis), Mohamed El Mahrouss (SUD Hôtellerie-Restauration), Karim Eljihad (Syndicat Local Construction CGT 37), Marius Faure-Brac (Solidaires étudiant-e-s Grenoble), Arnaud Fonteny (SNEP-FSU Loiret), Henri Fourtine (SNASUB-FSU), Rémy Frey (US CGT Commerces et services Gibert Joseph), Philippe Gaser (Union syndicale de la psychiatrie Languedoc-Roussillon), Edouard Gloanec (SUD Santé-Sociaux Gard Lozère), Laurent Godard (Solidaires Draguignan), Guillaume Goutte (Syndicat des correcteurs CGT), Eddy Guilain (UL CGT Douai), Gaétan Helon (Syndicat Etudiant.e.s et Lycéen.ne.s-CGT valenciennois), Hortensia Inès (CNT-SO éducation), Stanislas Jaunet (Cheminot CGT Nantes), Ronan Jeanne (CGT Chômeurs Lorient), Raymond Jousmet (Snes-FSU), Mohamed Khenniche (Solidaires Industrie), Sylvère Labis (syndicat des retraités interpro CGT du Florentinois), Christel Lacaille (SUD Solidaires MATMUT Ile-de-France), Kaou Lampriere (Solidaires Ille-et-Vilaine), Catherine Laurenti (FSU), Isabelle Le Roux-Meunier (CGT Banque de France), Emmanuelle Lefevre (SNUipp-FSU Loire Atlantique), Chantal Legeais (CNT-Solidarité ouvrière du Nettoyage Rhône-Alpes), Jean-Yves Lesage (Syndicat Général du Livre CGT), Philippe Levet (SNUipp-FSU), Claude Lévy (CGT Hôtels de Prestige et économiques), Nathalie Loinsard (CGT Santé Ile-et-Vilaine), Alexis Louvet (CGT RATP Bus), Grégory Marchand (CGT éduc’action 92), François Marchive (Solidaires Isère), Cathy Menard (SUD Culture-Solidaires Loiret), Bruno Menguy (CNT-Solidarité ouvrière Hôtellerie-Restauration Paris), François Millet (SNU Pôle Emploi FSU), Marie-Line Mongin (SUD Santé Sociaux Rhône), Franck Monvoisin (CNT-Solidarité ouvrière de la Société Oent nettoyage), Grégoire Nadin (SNTRS CGT), David Nimeskern (CNT usine Renault SOVAB Batilly), Hélène Ohresser (Solidaires Bouches-du-Rhône), Louise Paternoster (SUD éducation 93), Ramón Pino (Syndicat parisien des diffuseurs de presse CGT), Julien Plaisant (Solidaires Val-de-Marne), Thierry Porré (Syndicat des correcteurs CGT), Jeronimo Prieto (LAB), Yves Quignon (UL CGT Douai), Hugo Reis (Fédération SUD PTT), Eddy Reyes (CGT Cheminots 30), Valérie Richard (CFDT Décathlon Lorraine), Julien Rodrigues (syndicat CGT Services publics), Théo Roumier (Solidaires Loiret), Olivier Sagette (CGT Paris – Banques), Mathieu Santel (SUD Aérien), Eric Santinelli (Fédération SUD Rail), Marie-Paule Savajol (CGT éduc’action Orléans-Tours), Jérôme Schmidt (Fédération SUD énergie), Frédéric Siméon (CNT Wolters Kluwer France), Eric Sionneau (Solidaires Indre-et-Loire), Pierre Stambul (FSU), Damien Steiner (CGT Cultura), Stéphane Thiel (CNT garages Renault groupe GGBA), Vincent Touchaleaume (STEG UTG Cayenne, Guyane), Julien Troccaz (Solidaires Savoie), Sylvie Vénuat (SNICS-FSU Loiret), Olivier Vinay (FSU), Elise Vinauger (section SUD éducation Université d’Orléans), Christian Zueras (CGT Haute-Pyrénnées)…
Article de Rachel Saada paru dans le Monde Diplomatique de janvier 2016.
Deux siècles de luttes
Feu sur le droit et sur le code du travail, qui angoisseraient patrons et salariés et seraient responsables du chômage ! Ils doivent être réduits, ramenés à quelques grands principes, entend-on partout. Pourtant, avant de chercher à les déconstruire, il serait judicieux de voir comment ils se sont construits. Rien n’est là par hasard. Comme dans un écosystème, chaque élément est utile à certains, et le tout, utile à tous.
Cet édifice s’est élevé lentement au fil des siècles. Il s’est affermi dans la sueur et les larmes, parfois à cause de catastrophes industrielles ou de guerres. Et il n’a pas fini d’évoluer.
Dans le système économique d’après la Révolution française, il n’existe pas de droit du travail. Les rapports entre patrons et ouvriers sont régis par le contrat, le code civil précisant que celui-ci a force de loi. L’égalité entre les citoyens proclamée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 entraîne de facto l’égalité entre les contractants — une fiction juridique. La Révolution consolide ainsi le mythe de la liberté de négociation.
Le contrat lierait deux hommes libres et consentants, tous deux propriétaires, l’un de sa seule force de travail, l’autre de beaucoup plus et notamment des moyens de production, mais tous deux égaux malgré tout. M. François Rebsamen aurait pu sans risque d’anachronisme déclarer devant l’Assemblée nationale de l’époque, comme il l’a fait devant le Sénat le 22 mars 2015, alors qu’il était ministre du travail : « Le contrat de travail n’impose pas toujours un rapport de subordination ; il est signé entre deux personnes libres qui s’engagent mutuellement. » Cette liberté contractuelle se doublera alors de l’interdiction de tout groupement patronal ou ouvrier, ou de toute action concertée qui pourrait faire de l’ombre à la liberté de contracter d’individu à individu. C’est la loi dite Le Chapelier du 14 juin 1791.
Le travailleur donne donc à bail ses services, pour lesquels l’employeur paie un loyer (le salaire), comme un simple locataire. La force de travail n’étant qu’une marchandise, l’Etat n’a pas à intervenir : elle se régule par la logique de l’offre et de la demande. Déjà, on ne s’encombre pas de trop de lois dans ce domaine. La « pensée unique » de l’époque peut se résumer ainsi : « Ce qui est contractuel est juste. » Le code civil consacre 66 articles au louage de choses, dont 32 à celui du cheptel, et 2 seulement au « louage de service » — le contrat de travail du XIXe siècle.
La fiction de l’égalité des parties ne résiste pas à l’épreuve des faits, des maladies et des morts qui ponctuent les cent vingt années séparant la Révolution de la naissance d’un embryon de code du travail, en 1910. Il faut la misère des ouvriers et de leurs enfants — mise en lumière dans le rapport du docteur Louis René Villermé [1. A la suite de plusieurs pétitions réclamant une réglementation sur le travail des enfants, l’Académie des sciences morales décida en 1835 de se pencher sur le sujet et désigna deux enquêteurs : Louis-François Benoiston de Châteauneuf et Louis René Villermé.], qui dresse en 1840 un « tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie » — ainsi que les catastrophes industrielles pour que naisse le droit du travail moderne, celui-là même qui est vilipendé aujourd’hui.
Conçu pour que chacun puisse s’y retrouver
Quelques repères historiques aident à comprendre l’immensité de la tâche et sa difficulté, car, de tout temps, la doxa économique est venue s’y opposer. Ce n’est qu’en 1841, avec la loi du 22 mars, que le travail des enfants de moins de 12 ans a été limité à huit heures par jour, celui des moins de 8 ans prohibé dans les entreprises de plus de vingt salariés, et le travail de nuit interdit pour tous les enfants. Les débats à l’Assemblée ont été âpres. Le 5 mars 1841, l’économiste Pellegrino Rossi martèle ainsi : « Je le répète, cet enfant [qui ne travaillera plus] sera souvent la victime de la négligence de ses parents. N’oublions pas les égarements des passions humaines. Quand le salaire collectif de la famille se trouvera ainsi diminué, c’est sur l’enfant que retombera la colère d’un père ignorant et grossier ; c’est le plus faible qui en souffrira. » Malgré cet assaut d’arguments de haut vol, la loi est adoptée.
Celle du 26 mai 1864 abroge le délit de coalition, mettant ainsi fin à la pénalisation de la grève. Il est permis de constituer des syndicats professionnels après la loi du 21 mars 1884, mais il faudra attendre… 1968 pour que le syndicat puisse entrer dans l’entreprise, à travers la section syndicale. Toujours la prévalence du droit de propriété et de la règle du charbonnier maître chez lui.
Près d’un siècle après la Révolution, la loi du 10 mai 1874 interdit complètement le travail des enfants de moins de 12 ans. C’est aussi l’année de naissance de l’inspection du travail. Deux décennies plus tard, la loi du 12 juin 1893 obligera les employeurs à respecter des règles d’hygiène et de sécurité dans les usines et les manufactures, les morts et les estropiés se comptant par milliers et menaçant les recrutements dans l’armée. Puis, le 9 avril 1898, les accidents du travail sont reconnus en tant que tels : la loi instaure un régime de « responsabilité sans faute » des employeurs. L’indemnisation des accidentés est assurée en échange d’une certaine immunité patronale.
Mais, en ces années de révolution industrielle, la course à la productivité continue de tuer. La catastrophe de la mine de Courrières, le 10 mars 1906, fait plus de mille morts. Les grèves qui s’ensuivent imposent enfin le droit au repos dominical (loi du 13 juillet 1906). Loin d’entraver l’emploi, le code du travail le sauve, tout simplement.
En 1918, avec la démobilisation et le retour du front, les demandeurs d’emploi affluent ; le chômage menace. Sous la pression, le gouvernement accepte une réduction du temps de travail à huit heures par jour, six jours par semaine (loi du 23 avril 1919), afin de favoriser la création d’emplois. On expérimente alors le principe « Travailler moins pour travailler tous ».
Signés le 7 juin 1936 entre le patronat et la Confédération générale du travail (CGT), sous les auspices du gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum, les accords de Matignon sont restés dans les mémoires. Ils sont transposés dans la loi qui fixe la durée du travail à quarante heures hebdomadaires et donne aux salariés deux semaines de congés payés. Pour la première fois, la vie ne se réduit pas à l’aliénation au travail ; elle peut commencer à s’ouvrir sur autre chose.
Après l’horreur de la seconde guerre mondiale, dans un pays détruit et ruiné, les hommes et les femmes de la Libération, profitant de la position de faiblesse d’un patronat français qui s’est enrichi et a collaboré avec l’occupant allemand, posent les fondements du droit moderne : les comités d’entreprise, la Sécurité sociale [2. Lire Bernard Friot et Christine Jakse, « Une autre histoire de la Sécurité sociale », Le Monde diplomatique, décembre 2015.], la médecine du travail, les comités d’hygiène et de sécurité, les caisses de chômage, le salaire minimum.
Ces principes n’ont pas seulement germé dans la tête de quelques illuminés communistes ou gaullistes. La déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, adoptée à l’unanimité par l’Organisation internationale du travail (OIT), proclame en son article premier que « le travail n’est pas une marchandise », et en son article 2 qu’« une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale ». L’OIT reconnaît ainsi que le contrat qui considère le travail comme une marchandise a produit la guerre, relève Alain Supiot, professeur au Collège de France, dans L’Esprit de Philadelphie [3. Alain Supiot, L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Seuil, Paris, 2010.].
Mais, dans les années 1980 et 1990, deux facteurs vont converger : la contre-révolution libérale menée sous la houlette de Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, puis la soudaine conversion des pays européens se réclamant du communisme à l’économie de marché. Cette occasion historique permet de défaire les solidarités construites depuis la seconde guerre mondiale pour les remplacer par les dogmes du marché. Ainsi s’opère ce que Supiot appelle le « grand retournement ». Certes, en France, la contre-révolution est plus longue à mettre en œuvre que dans les pays anglo-saxons ; mais les gouvernements successifs n’y renoncent pas.
Ce bref rappel historique permet de mesurer l’inanité des discours relayés avec complaisance par certains journalistes, à l’exemple de David Pujadas qui, au journal télévisé de France 2, le 8 septembre 2015, abattait devant lui un épais volume, « notre fameux code du travail, si lourd avec ses près d’un kilo et demi » [4.Lire Gilles Balbastre, « Combien de pages valez-vous ? », Le Monde diplomatique, novembre 2014.]. Dans une société où la minceur fait l’objet d’un culte et passe pour un signe de bonne santé, le terme « obèse », souvent employé, n’a rien d’innocent : il signifie que le code du travail n’est pas seulement épais, mais aussi malade.
L’offensive vise à mettre à bas les principes mêmes du droit du travail, qui tempèrent encore quelque peu la logique de l’ultralibéralisme. Comme les critiques sont formulées pour de mauvaises raisons, elles ne peuvent reposer que sur des mensonges. M. Patrick Quinqueton, conseiller d’Etat, ancien inspecteur du travail, membre du groupe qui a travaillé en 2008 à la recodification souhaitée par le président Nicolas Sarkozy, rappelle que, si le nombre d’articles a été augmenté, c’est de façon délibérée, « en appliquant le principe selon lequel chacun, pour être compréhensible, ne doit comporter qu’une seule disposition [5. Patrick Quinqueton, « Le code du travail mérite-t-il d’être brûlé ? », Semaine sociale Lamy, no 1684, Paris, 2 juillet 2015.] ». Et si le code comporte de nombreuses parties, c’est précisément pour que tous puissent s’y retrouver, qu’ils soient salariés, dirigeants d’une très petite entreprise (TPE), d’une petite ou moyenne entreprise (PME) ou d’un grand groupe. Les TPE n’ont ainsi pas à connaître le chapitre des relations collectives, avec ses 105 articles sur les délégués du personnel ou les 289 autres consacrés aux comités d’entreprise.
De même, ce qui concerne la durée du travail et la rémunération a été regroupé dans la troisième partie. Les 210 articles relatifs au temps de travail ne s’appliquent pour l’essentiel qu’« à défaut d’accord de branche ou d’entreprise ». Ceux relatifs aux salaires ne portent que sur le respect du smic et sur la protection du salaire (par exemple contre les saisies). Enfin, comme le souligne toujours M. Quinqueton, la quatrième partie, relative à la santé et à la sécurité des travailleurs, comporte 2 500 articles. Serait-ce là que se niche la poche de graisse qui contrevient de façon si insupportable aux canons de beauté ?
Le plus souvent, il s’agit de dispositions techniques très précises pour une activité ou une autre, comme l’article sur la « prévention contre les risques chimiques » : « Les concentrations des agents présents dans l’atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser dans la zone de respiration des travailleurs les valeurs [ici définies]. » Suit une liste impressionnante de produits chimiques dangereux, comme l’acétone ou le chlorobenzène. Faudrait-il supprimer de telles dispositions ?
Une fable colportée depuis trente ans
En réalité, ceux qui se plaignent de la multiplication des textes y ont eux-mêmes contribué, puisque, depuis le début des années 1990, les employeurs ont réclamé et obtenu dérogation sur dérogation, soit autant de pages supplémentaires. Quant à l’idée selon laquelle les licenciements d’aujourd’hui feraient les emplois de demain, il y a plus de trente ans que le patronat colporte cette fable. Déjà, dans les années 1980, M. Yvon Gattaz, président du Conseil national du patronat français (CNPF) — l’ancêtre du Mouvement des entreprises de France (Medef), que dirige aujourd’hui son fils, M. Pierre Gattaz —, avait demandé et obtenu la suppression de l’autorisation administrative de licencier. Il clamait urbi et orbi que si les entreprises n’embauchaient pas, c’était parce qu’elles devaient demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier. Depuis 1986, plus besoin d’autorisation… mais pas d’embauches pour autant.
Dans les années 2000, il a été décrété que le droit du licenciement était compliqué : nécessité d’une convocation à entretien et énonciation écrite du motif. Les risques judiciaires encourus par l’employeur pouvaient mettre en danger l’entreprise, affirmait-on aussi. En janvier 2008, on a donc instauré la rupture conventionnelle : pas de convocation formelle, pas de motif à indiquer, pas de contestation possible devant le conseil des prud’hommes — sauf démonstration d’un vice du consentement. Résultat : un record de ruptures conventionnelles chaque année (plus d’un million en 2014) et pas d’embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) pour compenser [6. Lire Céline Mouzon, « Rupture conventionnelle, virer sans licencier », Le Monde diplomatique, janvier 2013.]. Au contraire : on remplace ces derniers par des contrats à durée déterminée (CDD), qui représentent 85 % des embauches. Et qui, jugés trop compliqués, sont désormais à leur tour dans le collimateur : l’idéal serait de les remplacer par des contrats de mission, aussi précaires, mais plus longs.
Martelant un discours qui n’est jamais décortiqué par les médias, les patrons répètent qu’ils veulent moins de lois, tout en réclamant et en obtenant une protection forte de l’Etat quand il s’agit de valider leurs plans de licenciements : avec la loi du 13 juin 2014, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) les homologuent en un temps record (vingt et un jours au plus tard après la demande patronale), et le juge ne peut plus s’en mêler. Une loi formidable, claire comme de l’eau de roche…
La violence du combat idéologique et l’inégalité des armes conduisent en général à adopter une position défensive, alors que des progrès sont encore possibles. Certains glorifient la négociation collective, parant le « dialogue social » de toutes les vertus ; mais cela a-t-il un sens au moment où les syndicats n’ont jamais été aussi faibles ? Il en résultera non pas une meilleure compréhension du droit, mais un émiettement des droits ainsi qu’une jurisprudence encore plus foisonnante. Et, contrairement à ce qu’assurent Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen dans leur ouvrage Le Travail et la loi, aucun lien entre protection des travailleurs et taux de chômage n’a jamais pu être démontré.
Le professeur de droit du travail Pascal Lokiec relève que ces polémiques dénotent « un changement profond dans la problématique du droit du travail ». On est en train, dit-il, « de sortir de l’opposition entre salariés et employeurs au profit d’une opposition entre travailleurs et chômeurs, entre travailleurs précaires et permanents » [7. Pascal Lokiec, Il faut sauver le droit du travail !, Odile Jacob, Paris, 2015.]. A ce jeu, salariés, chômeurs et précaires sortiront tous perdants…
Extrait de la préface à la seconde édition de Au-delà de l’emploi (2016, Flammarion) d’Alain Supiot.
Article paru sur Alterecoplus.
« Le droit du travail est dénoncé dans tous les pays européens comme le seul obstacle à la réalisation du droit au travail. A l’image du président Mao guidant le Grand Bond en avant [1. Imposé par Mao dans les années 1950 pour rattraper le niveau de développement des pays industrialisés, cette politique économique aveugle aux réalités a causé l’une des plus grandes famines de l’histoire, provoquant la mort de plus de 30 millions de personnes selon les estimations actuelles (cf. Yang Jisheng, Stèles. La Grande famine en Chine, 1958-1961, Paris, Seuil, 2012, 660 p.).], la classe dirigeante pense être l’agent historique d’un monde nouveau, dont l’avènement inéluctable exige de la population le sacrifice de toutes les sécurités acquises. Cette fuite en avant est éperdue chez les gouvernants des pays de la zone euro.
S’étant privés de tous les autres instruments de politique publique susceptibles de peser sur l’activité économique, ils s’agrippent au seul levier qui leur reste : celui de la déréglementation du droit du travail. Agrippement d’autant plus frénétique qu’ils sont désormais placés sous la menace des sanctions prévues par les traités, mais aussi et surtout de la perte de confiance des marchés financiers.
La Commission et la Banque centrale européenne les pressent de procéder aux « nécessaires réformes structurelles », nom de code de la « réduction du coût du travail » et de la « lutte contre les rigidités du marché du travail [2. Cf. les « Recommandations de la Commission européenne concernant le programme national de réforme de la France » publiées le 13 mai 2015, COM (2015) 260 final ; et dans le même sens, M. Draghi, « Réformes structurelles, inflation et politique monétaire », discours d’ouverture du président de la BCE, au forum consacré à l’activité de la Banque centrale (Sintra, le 22 mai 2015), accessible en ligne sur le site de la BCE (www.ecb.europa.eu).] ».
Relayé quotidiennement dans les médias par les talking classes [3. Christopher Lasch désigne ainsi la « classe jacassante », omniprésente dans les médias (La Révolte des élites, op. cit., p. 89).], l’appel à ces « réformes courageuses » est un mot d’ordre si rabâché depuis quarante ans, qu’on en oublierait presque l’obscénité du spectacle donné par ceux qui, cumulant souvent eux-mêmes les sécurités du public et les avantages du privé, dénoncent au nom des outsiders les avantages extravagants dont jouiraient les insiders et n’ont de cesse d’opposer les chômeurs aux smicards, les précaires aux titulaires d’un emploi stable, les salariés aux fonctionnaires, les actifs aux retraités, les immigrés aux indigènes, etc.
Que veut dire « réformer » ?
Une véritable réforme du droit du travail n’a évidemment rien à voir avec les sermons de ceux qui relaient ainsi la consigne de l’adaptation des hommes aux besoins d’un Marché devenu total. Ces prédicateurs s’inscrivent dans la lignée des « terribles simplificateurs [4. En français dans le texte d’une lettre de Jacob Burckhardt du 24 juillet 1889, Briefe an seinen Freund F. von Preen, 1864-1893, Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlag Anhalt, 1922, p. 248.] », dont Jacob Burckhardt annonçait l’« absolue brutalité [5. Cf. J. Nurdin, Le Rêve européen des penseurs allemands (1700-1950), Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2003, 296 p.]».
C’est un abus de langage en effet de qualifier de projets de réforme du droit du travail les appels à sa déréglementation. De tels projets sont au droit du travail ce que le redécoupage des régions a été à la réforme territoriale française décidée en 2014 : non pas l’expression d’une action politique réfléchie, mais des signaux destinés à satisfaire l’appel aux « réformes structurelles » ; non pas la source de plus de simplicité et de démocratie, mais au contraire de plus de complexité et de prébendes.
Il ne faut pas confondre en effet le transformisme, qui réduit la politique à la soumission aux contraintes du marché et à l’évolution des mœurs, avec le véritable réformisme, qui consiste à mettre politiquement en œuvre la représentation d’un monde plus libre et plus juste [6. Cf. B. Trentin, La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale, Rome, Editori reuniti, 2004, p. 128.]. Réformer le droit du travail exige de prendre la mesure de l’extrême complexité et des transformations profondes de la division du travail dans le monde contemporain, et d’imaginer sur cette base des catégories juridiques nouvelles, propres à favoriser la liberté, la sécurité et la responsabilité de tous les travailleurs. (…)
Un vieux procès
Au moment où nous rédigions notre rapport [c’est-à-dire en 1999, N.D.L.R.] les pratiques des entreprises, peu à peu légalisées, voire encouragées par les Etats, promouvaient déjà depuis des années le travail précaire, à durée déterminée, le travail à temps partiel, la mise à leur compte de travailleurs plus ou moins indépendants, la pluriactivité, la sous-traitance, le recours à des travailleurs détachés, l’intermittence, etc.
Et depuis des années déjà, la difficulté des entreprises à créer de l’emploi était imputée à un droit du travail devenu trop protecteur et trop complexe. Dès 1984, M. Yvon Gattaz – président du CNPF et père de l’actuel président du Medef – promettait l’embauche de 471 000 salariés moyennant la création d’« emplois nouveaux à contraintes allégées » (Enca). C’est pour répondre à cette demande que fut supprimée en 1986 la suppression de l’autorisation préalable de licenciement, qui ne se solda par aucune création nette d’emplois.
L’argument n’en est pas moins repris aujourd’hui par les organisations patronales, selon une démarche typiquement française[7. On n’imaginerait pas le dirigeant d’une grande entreprise allemande qui, perdant des parts de marché, en imputerait la responsabilité à la Bundesrepublik au lieu de commencer par s’interroger sur la sienne. Il est vrai que les patrons allemands sont le plus souvent sortis du rang et ont une culture industrielle qui fait défaut à leurs homologues français, sortis du moule des grandes écoles et habitués à passer du public au privé. Cf. Hervé Joly (dir.), Formation des élites en France et en Allemagne, Paris, CIRAC, 2005, 228 p. ; Joël Massol, Thomas Vallée et Thomas Koch, « Les élites économiques sont-elles encore si différentes en France et en Allemagne ? », Regards sur l’économie allemande, no 97, 2010, p. 5-14.]. L’Etat en France est « l’ennemi commun mais aussi l’allié de tous » . Comme les médecins, les agriculteurs, les universitaires ou les motards en colère, bref comme tout ce que la France compte de corporations, les dirigeants d’entreprise imputent toujours leurs difficultés d’abord à l’Etat plutôt qu’à eux-mêmes. Tous se tournent vers la République comme vers une « Big Mother » dont on dénonce l’envahissement tout en en réclamant l’aide [8. Michel Schneider, Big Mother : Psychopathologie de la vie politique, Paris, Odile Jacob, 2005, 379 p.].
L’argument a donc pu sans peine être répété en chœur par le monde politique et les experts de tout poil : le premier responsable du chômage, c’est le code du travail ! Qu’attend donc le gouvernement pour en réduire drastiquement le volume et voir refleurir l’emploi en France ?
Simplifier ou déréglementer ?
C’est dans ce contexte que de bons esprits ont récemment déclaré avoir découvert un « remède à portée de main » à la lutte contre le chômage : une simplification drastique du droit du travail, ramené à cinquante principes, qui en seraient autant de « poutres maîtresses [9. Cf. R. Badinter et A. Lyon-Caen, « Pour une Déclaration des droits du travail », Le Monde du 6 juin 2015, et la version un peu plus longue publiée sous le titre Le Travail et la Loi, Paris, Fayard, 2015, p. 80.] ».
Les meilleurs spécialistes n’ont pas manqué de noter que des principes pourtant aujourd’hui reconnus en droit français, comme le droit de grève [10. E. Dockès, « Préservons un système qui protège les employés, Le Monde, 27 juin 2015, p. 15.] ou le salaire minimum [11. J.-J. Dupeyroux, « Faut-il simplifier le Code du travail ? », L’Observateur, 27 août 2015. ], ne figuraient pas dans cette liste. Tandis qu’en revanche s’y trouve promu un « principe » jusqu’ici inconnu : celui de la prescription triennale des salaires, dérogatoire au droit commun et défavorable aux salariés [12. J.-J. Dupeyroux, « Faut-il simplifier le Code du travail ? », art. cité.]. Ce qui laisse entrevoir sous la paille de la simplification le grain de la déréglementation.
« Séquence » politique
La publication de cet ouvrage s’est du reste inscrite dans une « séquence » politique coordonnée par le Premier ministre et destinée à répondre aux consignes européennes de « réforme structurelle » du droit du travail. Dans sa lettre de mission du 1er avril 2015, le Premier ministre demandait au président de la section sociale du Conseil d’Etat, M. Jean-Denis Combrexelle, de conduire une réflexion sur « la place des accords collectifs en droit du travail et la construction des normes sociales », en lui indiquant qu’il « aura profit à examiner les contributions des think tanks et publications à venir [13. Cf. le texte de cette lettre de mission, reproduit en annexe du rapport de J.-D. Combrexelle cité infra.] ».
Ont été publiés dans la foulée, en juin 2015 l’ouvrage de MM. Badinter et Lyon-Caen, et en septembre deux rapports de ces fameux think tanks : l’un de l’Institut Montaigne proposant de « sauver le dialogue social » et l’autre de l’institut Terra Nova indiquant comment « Réformer le droit du travail ». Clôturant cette séquence, M. Combrexelle pouvait remettre le 9 septembre 2015 son rapport, dont les conclusions allaient évidemment dans le même sens [14. J.-D. Combrexelle, La Négociation collective, le travail et l’emploi, rapport au Premier ministre, France Stratégie, septembre 2015, p. 135.]. Cette publication a ouvert une nouvelle « séquence », avec la nomination d’une commission présidée par M. Badinter chargée de définir les « principes fondamentaux du droit du travail ».
Etendre la négociation d’entreprise
Face à « l’obésité » du code, la « réforme » du droit du travail consistera à étendre considérablement le champ de la négociation d’entreprise, en réduisant celui de l’ordre public et en limitant la capacité de résistance éventuelle que les salariés tirent de leur contrat individuel. Ce qui frappe le plus dans cette résurgence du vieux projet de « contrat collectif d’entreprise » est d’abord son caractère suranné. C’est une vieille idée puisée dans les recettes du néolibéralisme, d’abord avancée par le Premier ministre Raymond Barre dans les années 1970, puis dans les années 1980 et 1990 sous le nom de « contrat collectif d’entreprise » [15. J.-D. Combrexelle, La Négociation collective, le travail et l’emploi, rapport au Premier ministre, France Stratégie, septembre 2015, p. 48.] ». Elle participe de l’agenda néolibéral des années 1970, qui a déjà été largement mis en œuvre et dont il serait avisé de dresser le bilan plutôt que de continuer à y obéir aveuglément.
Depuis trente ans en effet – contrairement aux poncifs sur l’aversion française aux réformes –, toutes les potions du néolibéralisme censées doper la croissance et l’emploi ont été administrées à notre pays : la corporate governance, le new public management, la déréglementation des marchés financiers, la réforme des normes comptables, l’institution d’une monnaie hors contrôle politique, l’effacement des frontières commerciales du marché européen… Et bien sûr la déconstruction du droit du travail, objet d’interventions législatives incessantes et source première de l’obésité (réelle) du code du travail.
Le mauvais bilan du libéralisme
Mais quel est le bilan de ces réformes ? La déréglementation des marchés financiers a conduit à leur implosion en 2008, suivie de l’explosion du chômage et de l’endettement public. La corporate governance, en indexant les intérêts des dirigeants des grandes entreprises sur le rendement financier à court terme, a précipité ces dernières dans un temps entropique incompatible avec l’action d’entreprendre, l’investissement productif et donc… l’emploi. Quant au droit du travail, le reflux de la loi au profit de la négociation collective a déjà été largement engagé.
Avec quels résultats ? M. Combrexelle a le mérite de le dire clairement : « La négociation collective n’est plus adaptée aux exigences d’une économie moderne et mondialisée, les acteurs sont fatigués et dépassés, les résultats sont décevants, bref la négociation collective ne permet pas d’obtenir des résultats conformes à l’intérêt général[16. « Comme en témoigne la lettre de mission du Premier ministre, le gouvernement fait clairement le choix de [cette] option », J.-D. Combrexelle, rapp. cité, p. 49).]. » S’il recommande de persévérer dans cette voie, c’est explicitement par devoir plutôt que par conviction.
Pourquoi le code du travail est-il obèse ?
Il est vrai que le code du travail est devenu énorme et compliqué. Cela pour au moins deux raisons. La première, évoquée dans notre rapport, est que le droit du travail régit aujourd’hui la plus grande partie de la population active ; non plus une classe ouvrière homogène mais un monde du travail hétérogène et complexe. Or, le propre d’un droit codifié est de réunir dans un même codex les règles répondant à cette complexité et cette hétérogénéité.
Dans les pays où cette législation est éparpillée en textes divers, la pratique éprouve le besoin de compilations, dont le volume n’a rien à envier à notre code. Par exemple en Allemagne le Arbeitsrechts-Handbuch : Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis, qui compte 3 030 pages dans son édition 2015 et pèse plus de 2 kg. Et si l’on veut comparer ce qui est vraiment comparable, on pourrait mettre en regard de notre code du travail, celui du commerce ou le code général des impôts, puisque tous s’appliquent également aux entreprises. Si l’on prend les excellentes versions annotées publiées en 2015 par les éditions Dalloz, on constate que ces codes sont aussi volumineux (environ 3 800 pages) que le code du travail.
Sans que l’on dénonce le poids écrasant qu’ils feraient peser sur les petits entrepreneurs, ni que l’on s’interroge sur l’impact du droit commercial ou du droit fiscal sur l’emploi. Or, si l’on s’avisait de publier à l’intention des entreprises de moins de onze salariés (soit plus des deux tiers des entreprises françaises, employant un salarié sur cinq), une version du code du travail restreinte aux seules dispositions qui les concernent, il s’agirait d’un ouvrage assez mince et d’un accès assez commode.
Calcul économique
La seconde raison de l’inflation des lois en droit du travail est l’asservissement de ces dernières au calcul économique. Réduite à l’état d’outil de politique économique, la loi dégénère en bavardage normatif abscons et inconstant. Déjà à l’œuvre dans la planification soviétique, cette instrumentalisation de la loi est aujourd’hui théorisée par la doctrine Law and Economics et mise en œuvre par les « politiques de l’emploi » et de « fluidification du marché du travail », qui sont aujourd’hui la principale source de l’obésité et de la complexité du code du travail.
Ainsi, le démantèlement progressif de la règle claire et simple du repos dominical [17. Code du travail, article L.3132-3. ] a conduit depuis une dizaine d’années à un empilement de dispositions législatives, dont la couche la plus récente (loi dite « Macron » du 7 août 2015) a ajouté sur ce seul sujet au code du travail quinze articles d’un volume équivalent de cinq pleines pages du Journal officiel [18. Code du travail, article L.3132-20 à 3132-27-2]. Promulguée dix jours plus tard, la loi « Rebsamen » l’a lesté de 43 pages supplémentaires, destinées selon son exposé des motifs à « simplifier les obligations d’information, de consultation et de négociation dans l’entreprise »…
L’épuisement du modèle industriel de l’emploi
Le procès ainsi instruit contre le code du travail occulte les causes profondes de la crise de l’emploi. Ces causes sont à rechercher dans l’effacement des frontières du commerce, dans la révolution informatique et dans la dictature des marchés financiers, qui se conjuguent pour saper les bases économiques et territoriales de l’Etat social et pour mettre les travailleurs du monde entier en concurrence, en vue de l’établissement de ce que Friedrich Hayek, l’un des pères de l’ultralibéralisme, a nommé la catallaxie, c’est-à-dire « l’ordre engendré par l’ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché [F.A. Hayek, Le Mirage de la justice sociale (1976), PUF, 1981, p. 131.] ».
Quand nous avons entrepris nos travaux, l’échec de toutes les politiques (de droite comme de gauche) de flexibilisation de l’emploi pour lutter contre le chômage sautait déjà aux yeux. Le développement du travail précaire sous toutes ses formes, les différents dispositifs « ciblés » sur les jeunes, vieux, chômeurs de longue durée… avaient montré leur impuissance pour assurer à toute la population un travail décent, en dépit de l’allègement des charges sociales et de la restriction des droits sociaux qu’ils autorisent.
Ces mesures ont en revanche eu pour effet de réduire le périmètre et le niveau de la protection sociale attachée à l’emploi. Elles participent aussi du mouvement plus général de mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres : européens contre immigrés, salariés contre fonctionnaires, titulaires d’un CDI contre précaires, jeunes contre vieux, Français ou Allemands contre Polonais ou Grecs… Cette mise en concurrence détruit les solidarités nécessaires à une action revendicative commune, engendre la division syndicale et attise les repliements corporatistes et xénophobes [20. De 2006 à 2011, le nombre de travailleurs détachés en France, avec une déclaration en bonne et due forme, a été multiplié par quatre, passant de 37 924 salariés à 144 411. Il a augmenté de 8 % au cours de la seule année 2014, atteignant 230 000 salariés. Le nombre des détachés « irréguliers » serait à peu près équivalent. L’économie pour l’utilisateur est considérable puisque le travailleur détaché n’est pas assujetti aux cotisations sociales du pays d’accueil (en France un ouvrier polonais dans le BTP revient ainsi 30 % moins cher que son « concurrent » français ou malien en situation régulière). Voir le rapport du sénateur Éric Bocquet fait au nom de la commission des affaires européennes, no 527 (2012-2013), 18 avril 2013 ; Les Échos, 12 février 2015.]. »
Clip confédéral contre le projet de loi El Khomri de réforme du Code du travail
Clip confédéral de la CNT contre le projet de loi El Khomri
Posté par CNT Lille sur mercredi 2 mars 2016
Posté par CNT Lille sur mercredi 2 mars 2016
Et pourtant, ils existent : histoire du syndicalisme d’action directe en France de 1895 à nos jours.
Documentaire de Michel Mathurin co-produit par « Acracia Film » et « Atelier du Soir ».
Combien de personnes savent que la CGT, quand elle s’est constituée, était différente des syndicats dits représentatifs actuels ? Entre 1895 et 1914, le syndicalisme révolutionnaire mise sur l’efficacité de la grève générale pour renverser d’un seul coup la démocratie bourgeoise et le régime capitaliste. En 1906, la Charte d’Amiens est largement influencée par les partisans de l’action directe. Cette influence vient de la 1ere Internationale, de la Commune, de la Fédération des bourses du Travail lancée par Fernand Pelloutier et traversée par le courant anarcho-syndicaliste. Cet héritage sera revendiqué par la CGT-SR de 1926 à 1939 et la CNT depuis 1946.
Avec les interventions de :
- David Rappe;
- Franck Mintz;
- Michel Fabre;
- Stéphane Dinard.
https://www.youtube.com/watch?v=uDpjhg7TFhE
Article initialement paru sur Mouvements
Il est courant dans les milieux militants révolutionnaires ou tout simplement progressistes de dénoncer l’institution judiciaire et les arrêts qu’elle rend comme relevant d’une justice de classe. Reste à savoir ce que nous mettons derrière cette expression et quelle réalité nous désignons.
Dans Surveiller et punir, Michel Foucault évoque la justice de classe en ces termes : « si on peut parler d’une justice de classe ce n’est pas seulement parce que la loi elle-même ou la manière de l’appliquer servent les intérêts d’une classe, c’est que toute la gestion différentielle des illégalismes par l’intermédiaire de la pénalité fait partie de ces mécanismes de domination. Les châtiments légaux sont à replacer dans une stratégie globale des illégalismes »[1. FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, Ed. Gallimard, Coll. NRF, P.277.].
Dans cette optique, c’est en s’attardant sur le traitement des délinquances dites « complexes » (environnementale, économique, droit du travail, etc.) et non, comme on le fait habituellement, sur la délinquance de droit commun, que le fonctionnement de la justice de classe se laisse appréhender au mieux.
Ce qu’on peut qualifier, à juste titre, de justice de classe ne se donne jamais aussi bien à voir que lorsque l’on se situe aux marges du droit commun, dans le traitement des illégalismes en col blanc. De ce point de vue, rendre visibles ces délinquances volontiers invisibles (médiatiquement, politiquement) se révèle souvent édifiant pour le profane.
Dans le cadre du présent article nous allons évoquer le traitement de la délinquance patronale à travers le prisme du droit du travail et du sort réservé à l’institution étatique chargée de faire respecter ce droit : l’inspection du travail.
Car pour reprendre les termes de Foucault, les infractions au droit du travail font bien l’objet d’une gestion entièrement différenciée d’un bout à l’autre de la chaîne pénale:
- par les moyens réels accordés à l’inspection du travail, police du droit du travail ;
- par la façon dont l’institution judiciaire traite les procédures de l’inspection du travail ;
- par le type de pénalité appliquée au droit du travail, le droit pénal du travail étant dérogatoire ;
- par la délégitimation systématique du droit du travail par le pouvoir politique et l’administration du travail, sur fond de discours sécuritaire ambiant.
1. Les moyens de l’inspection du travail
Institution étatique créée à la fin du XIXe[2. Après deux esquisses, en 1841, puis en 1874, c’est la loi du 2 novembre 1892 encadrant le travail des femmes et des enfants dans l’industrie qui crée un corps d’inspecteurs du travail chargés de faire appliquer les premières lois sociales.], l’inspection du travail a pour mission de veiller au respect du droit du travail dans les entreprises. Ce droit particulier régit les relations entre les employeur.euses et les salarié.es individuellement et collectivement. Historiquement, le droit du travail s’est construit contre le pouvoir absolu de l’employeur.euse, avec pour fonction d’instituer et de faire respecter des règles et des droits minimums communs à tous les salarié.es. C’est dire qu’il est un enjeu perpétuel de la lutte des classes et le baromètre du rapport de force qui se joue entre travail et capital.
Or, la première chose qui frappe lorsqu’on observe la police du droit du travail qu’est l’inspection du travail, c’est son sous-effectif chronique, structurel.
Dans un livre intitulé, Carnets d’un inspecteur du travail, Gérard Filoche, lui-même ancien inspecteur du travail, note que « créée il y a plus de cent ans, en 1892, l’inspection du travail qui ne comptait que quelques dizaines de membres à ces débuts n’en a guère plus proportionnellement, au début du XXIe siècle »[3. FILOCHE Gérard, Carnets d’un inspecteur du travail, Ed. Ramsay, p.306-307.].
En 1902, il y avait 110 inspecteur.trices pour 3 millions de salarié.es, trois lois et 80 décrets. Aujourd’hui, on compte environ 2100 agent.es de contrôle en section d’inspection pour environ 10 000 articles du code du travail (3700 lois et 6300 décrets)[4. Ces chiffres ne prennent en compte que le code du travail dit « généraliste ». Depuis la fusion des services généralistes avec l’inspection du travail des transports, il faut également y rajouter le code des transports et la réglementation sociale européenne propre à ce secteur.]et 18,2 millions de salarié.es[5. Soit 3,7 inspecteurs pour 100 000 salarié.es en 1902 contre 11,5 pour 100 000 aujourd’hui. Les chiffres relatifs à l’action de l’inspection du travail sont issus du rapport sur « L’inspection du travail en 2013 » publié par le ministère du travail pages 7-8. http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_IT_2013_Web.pdf].
Avec des effectifs aussi dérisoires, il n’y a guère de miracle possible. Aujourd’hui comme hier, les agent.es de contrôle sont pris.es sous un flot continu de sollicitations qu’il.les ne peuvent traiter de façon satisfaisante. L’urgence devient la norme et le retard est structurel. Si l’on devait ne retenir qu’un chiffre, en rapportant le nombre de contrôles en entreprises au nombre total d’entreprises, les entreprises ont actuellement une chance de se faire contrôler une fois tous les 11 ans[6. Toujours selon le rapport sur l’inspection du travail suscité, 294 000 interventions ont été effectuées en 2013. Parmi ces interventions 57% relevaient de contrôles à proprement parler soit 167580 contrôles pour 1, 80 millions d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail.]. A titre comparatif, on peut également noter que le ratio du nombre de salarié.es par agent.e de contrôle est de 8710, en augmentation constante depuis 5 ans[7. En 2010 ce ratio était de un agent de contrôle pour 8114 salariés.], là où l’on compte approximativement un.e policier.ère ou gendarme pour 270 administré.es[8. En 2010 on comptait 243 000 policiers et gendarmes. Cf http://blogs.mediapart.fr/blog/laurent-mucchielli/191110/policiers-et-gendarmes-ont-ils-les-moyens-dassurer-la-securite-q].
Autant dire que, même avec la meilleure volonté des agent.es de contrôle, la pression de l’administration sur les entreprises ne saurait être féroce. Ces quelques rappels factuels nous paraissent être un préliminaire indispensable à rapporter aux larmoiements perpétuels du patronat sur la pression intolérable que l’administration ferait peser sur les entreprises. Dans une déclaration du 13 mai 2014, Pierre GATTAZ, président du MEDEF, déclarait encore « sur le terrain, le MEDEF constate une multiplication des contrôles tatillons et inutiles »[9. http://www.medef.com/medef-tv/actualites/detail/article/le-medef-sengage-pour-lemploi-mais-sinquiete-sur-le-pacte-de-responsabilite-1.html].
Malheureusement, la police du travail n’en a tout simplement pas les moyens.
2. Le devenir des procédures de l’inspection
Lors de leurs contrôles, les agent.es sont amenés à constater des infractions. Plusieurs suites sont alors possibles.
Il faut d’abord souligner que les agent.es privilégient très largement les courriers d’observation, qui constituent de simples rappels à la loi. Comme le relève la journaliste Fanny Doumayrou, l’action de contrôle consiste le plus souvent en un « long et fastidieux travail de pression sur l’employeur, à coup de lettres d’observations et de contre-visites, sous la menace plus ou moins explicite d’un procès-verbal »[10. Fanny DOUMAYROU, Qui défendra les inspecteurs du travail ?. Le Monde Diplomatique, Décembre 2012.]. Les PV n’interviennent donc la plupart du temps qu’en dernier recours et ne correspondent qu’à une petite partie des infractions constatées : en 2013, sur 294 000 interventions recensées, 183 500 lettres d’observations ont été rédigées et 6374 PV ont été établis. Par rapport aux constats d’infraction, seulement 4 % des situations donnent lieu à transmission de PV[11. Ici encore nous sommes très loin des éternels couinements patronaux sur une administration qui serait obnubilée par une sanction immédiate : « Nous demandons, là aussi, au gouvernement, à l’administration, de faire très attention à ce qu’on passe d’un climat de contrainte-contrôle-sanction qui existe depuis une trentaine d’années en France à un environnement d’accompagnement, de conseil, de motivation. Je pense même qu’au sein des administrations sociales ou fiscales, il serait bon d’éviter la sanction immédiate, le contrôle immédiat et d’avoir, comme en Angleterre, aux Etats-Unis, des administrations conseillères, qui aident et qui permettent de dire « on a détecté ça, c’est un point de dysfonctionnement, voilà ce qu’il faut que vous fassiez et vous avez 3 mois, 6 mois pour vous mettre d’équerre ».http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-presse/conferences-de-presse/conferences-de-presse/article/point-presse-mensuel-de-mai-2014.html].
Deux raisons principales viennent expliquer cette réticence à établir des P.V.
Tout d’abord, le manque de moyens et donc de temps pour dresser des procès-verbaux, l’investissement nécessaire à la rédaction d’un procès-verbal étant souvent plus important que la rédaction d’une lettre d’observations.
Mais, d’autre part, on peut y voir un effet du découragement des agent.es devant le sort qui est réservé à leurs procès-verbaux. Lorsqu’il y a procès-verbal, celui-ci est ensuite transmis au procureur de la République, qui demeure libre d’en faire ce qu’il veut selon le principe « d’opportunité des suites »[12. Si la loi Perben II impose une motivation au classement, cette motivation se réduit de fait bien souvent à la formule passe-partout : « infraction insuffisamment caractérisée ».]. Les données disponibles à ce sujet sont édifiantes.
Face aux protestations récurrentes des syndicats de l’inspection du travail concernant le devenir de leurs procédures, la Direction Générale du Travail (DGT) a créé en son sein un observatoire des suites pénales en 2007. Sur la période 2004-2009, près de 29 000 PV ont été dressés. Sur ce total, il s’avère que l’on a perdu la trace de presque un PV sur deux. La moitié des procès-verbaux se sont ainsi purement et simplement volatilisés ! Ce tour de magie se double d’un taux de classement sans suite de 25%. Au bout du compte, seul un quart des PV donnent effectivement lieu à des poursuites[13. http://www.sante-et-travail.fr/securite-du-travail—flagrant-deni-de-justice_fr_art_919_48804.html]. On est ici bien loin du discours sécuritaire sur la tolérance zéro et l’automaticité des condamnations. Celles-ci sont d’ailleurs dans leur immense majorité de simples amendes. En 2009, 7 082 procès-verbaux ont été dressés. Ils ont donné lieu à 1 147 poursuites, puis à 935 condamnations, dont 663 amendes et 144 peines d’emprisonnement très majoritairement assorties d’un sursis[14. http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_IT_2013_annexes_Web.pdf]. Et l’on retrouve ici la conclusion du sociologue Bruno Aubusson de Cavarlay qui déclarait en 1985 : « Veut-on caricaturer ? L’amende est bourgeoise et petite-bourgeoise, l’emprisonnement ferme est sous-prolétarien, l’emprisonnement avec sursis est populaire »[15. Bruno Aubusson de Cavarlay, « Hommes, peines et infractions : la légalité de l’inégalité », L’Année sociologique, vol. 35, n°2, Paris, 1985.].
3. Dans la tête des magistrat.es
Comment comprendre de tels chiffres ? En d’autres termes, comment s’opère ce tri spécifique des illégalismes liés au droit du travail ?
On peut commencer par écarter l’alibi technique. Les différents rapports IGAS annuels sur l’activité jugent les actes juridiques produits par l’inspection du travail comme étant plutôt de bonne qualité. Ce n’est donc pas la piètre qualité des procédures qui justifie un tel taux de classement des procès-verbaux.
Une première tentative d’explication consisterait à relever l’engorgement des tribunaux et le manque de moyens de la justice. Mais si cet engorgement est bien réel, une telle approche ne permet pas de comprendre comment s’effectue le tri des procédures et selon quels schémas de pensée.
Lors des rencontres périodiques organisées entre le parquet et les services de l’inspection, j’ai toujours été frappé par le discours des procureur.es, non pas tant par ce qu’il disait de nos procédures, mais par ce qu’il révélait de leur imaginaire pénal. Cet inconscient pénal peut se résumer par l’application de schémas de pensée de droit commun, en fait de la petite et moyenne délinquance sur les biens et les personnes, aux questions de droit du travail.
Plus précisément, cet inconscient pénal s’incarne dans l’idée plus ou moins explicitée que pour pouvoir condamner en bonne et due forme, il convient d’avoir une victime individuelle qui subit un préjudice immédiat de la part d’un bourreau, les deux étant reliés par un lien de cause à effet direct. Si l’on veut prendre un exemple, une personne agressée par une autre, voilà un schéma simple et qui correspond au sens commun judiciaire avec victime (l’agressé), bourreau (l’agresseur), préjudice (nombre de jours d’ITT éventuel) et lien direct entre l’agression et le préjudice subi.
C’est cette conception de l’infraction et de la responsabilité que j’appellerais l’inconscient de classe des magistrat.es. Conception qui témoigne d’une méconnaissance profonde du droit du travail et du monde du travail dans notre société capitaliste. La relation de travail, comme chaun.e sait, ne met pas face à face deux personnes « à égalité » mais se caractérise par une relation de subordination. C’est cette subordination qui justifie l’existence d’un droit spécifique du travail à côté des règles régissant les contrats commerciaux. Encore faut-il en tirer toutes les conséquences d’un point de vue judiciaire.
3.1. À la recherche de la victime…
Si l’employeur a un pouvoir général d’encadrement et de direction, son pendant est sa responsabilité générale concernant l’application du droit du travail, et notamment la préservation de la santé et de la sécurité dans son entreprise. Et ce, même si les infractions constatées ne correspondent pas au schéma d’une plainte individuelle d’une victime avec un préjudice directement constatable.
Ainsi, certaines infractions ne sont littéralement pas comprises si l’on veut leur appliquer le schéma de droit commun à toute force. C’est notamment le cas des infractions au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP), comme l’absence de consultation d’un comité d’entreprise ou le défaut d’organisation d’élections de délégués du personnel.
Or, si l’on se reporte toujours aux données des suites pénales pour l’année 2009, les procédures concernant la représentation du personnel sont celles qui sont le moins suivies par les magistrat.es : seules 23% d’entre elles ont donné lieu à des poursuites de la part du parquet. Sur ces 23% de procédures suivies, on peut encore retrancher 14% de dispense de peine et 4% de relaxe quand ces procédures arrivent en jugement.
Ces procédures ont l’inconvénient de ne pas permettre la mise en évidence de victimes ensanglantées: les enjeux ne sont alors bien souvent pas compris par les magistrat.es. Pourtant, une connaissance minimale du monde du travail ferait saisir l’importance fondamentale de l’existence et du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel pour l’ensemble des droits des travailleur.ses au sein d’une entreprise, et au-delà. Le désert syndical de plus en plus grand de notre société, notamment dû aux stratégies anti-syndicales du patronat bafouant le fonctionnement des IRP, devrait pourtant inciter l’Etat à en faire une priorité politique. Notre gouvernement, qui « aime l’entreprise » comme ceux qui l’ont précédé, a manifestement d’autres priorités puisque le projet de loi Macron prévoit d’alléger les pénalités concernant le délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel, en supprimant la possibilité d’infliger des peines de prison[16. Peine de prison, faut-il le préciser, pour ainsi dire jamais appliquée. Néanmoins, en mai 2010, l’affaire Molex ayant exceptionnellement abouti à des peines de prison avec sursis contre les dirigeants américains de cette société pour ne pas avoir informé les représentants du personnel de la fermeture de l’usine, le patronat a su faire usage d’un lobbying efficace pour supprimer un tel épouvantail.].
Dans ce cadre, on pourrait penser que la thématique santé/sécurité se voit réserver un meilleur sort. L’expérience montre pourtant que la mise en évidence d’une victime directe reste tout autant incontournable. Ce qui signifie notamment que l’ensemble des infractions qui touchent au domaine de la prévention collective (durée du travail, machines non conformes hors contexte d’accident, etc.) sans plaintes directes des victimes à la barre avec un préjudice immédiatement visible sont elles aussi difficilement comprises par notre système judiciaire. Au stade de la prévention, on ne peut distinguer ni victime, ni responsable du délit : d’où le peu d’intérêt à poursuivre et plus encore à condamner de façon dissuasive. Concrètement, il faut donc souvent attendre l’accident grave pour que soit mises en œuvre des poursuites et une condamnation effective. Pour autant, même lorsqu’il y a une victime clairement identifiable comme dans un accident du travail, il faut que la victime se porte partie civile pour espérer raisonnablement une poursuite et une condamnation. La partie civile aura alors le rôle d’incarner la figure de la victime en chair et en os, avec ses blessures et ses éventuelles séquelles et traumatismes. Le juge retombe alors dans le schéma que nous avons décrit avec une victime plaignante et un préjudice incarné. Autant dire que lorsque le salarié est toujours dans l’entreprise et qu’il ou elle souhaite y rester, il n’y a presque aucune chance pour qu’il se porte partie civile contre son employeur. Là comme ailleurs, le lien de subordination fait son œuvre dissuasive.
3.2 … et du bourreau
Une fois la victime mise en évidence vient la question du responsable.
Au premier abord on pourrait penser que cette question ne pose pas de difficulté particulière car l’auteur est le plus souvent parfaitement connu. Il s’agit de l’employeur, même si une discussion pourra éventuellement intervenir en cas de délégation de pouvoir. Comme nous l’avons déjà noté, le monde du travail capitaliste se caractérise par une relation de subordination constitutive du salariat. La subordination n’est pas une fiction juridique, elle s’incarne concrètement par un pouvoir de direction, de surveillance, de contrôle et de sanctions. En contrepartie de ce pouvoir exorbitant, le patron est responsable de l’application du droit du travail comme de ses manquements.
Pourtant, là encore, les magistrat.es essayent trop souvent d’appliquer des schémas de pensée juridique calqués sur la délinquance de droit commun, en recherchant une causalité directe entre les agissements du patron et un accident touchant par exemple l’un.e de ses salarié.es. Sur cette base, et selon la formule consacrée, les PV de l’inspection du travail sont toujours susceptibles d’être classés pour cause d’« infraction insuffisamment caractérisée » et ce, alors même que l’infraction est parfaitement constituée et constatée par l’agent de contrôle.
3.3 La faiblesse de la pénalité en droit du travail
Si les procédures se voient appliquer des systèmes de représentation de la délinquance propres au droit commun, le droit pénal du travail est lui-même un droit pénal dérogatoire.
Sommées de se justifier en permanence selon une grille de lecture de droit commun pour éviter le classement sans suite, les procédures de l’inspection se voient en revanche appliquer un droit pénal beaucoup plus « souple » et indulgent que le droit pénal commun. Les procédures de l’inspection sont en quelque sorte perdantes des deux côtés. Non seulement, comme nous l’avons vu, les condamnations sont rares, mais les sanctions sont elles-mêmes loin d’être à la hauteur.
Dans le Code pénal, une personne qui met en danger la vie d’autrui encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, alors que les sanctions prévues par le Code du travail en matière de santé/sécurité ne peuvent excéder 3750 euros par salarié. De même, le Code pénal punit l’homicide involontaire d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Or, là encore, le droit pénal du travail prévu par le Code du travail se borne à une amende délictuelle de 3750 euros.
Des pénalités aussi faibles posent inévitablement la question du caractère dissuasif ou pédagogique de la sanction. Les patron.nes, pour peu qu’il.les soient bien conseillé.es par un.e avocat.e ou par des syndicats patronaux, sont parfaitement capables d’évaluer les forces en présence. Provisionner le risque du contentieux devient une stratégie patronale à part entière. Stratégie payante, lorsqu’on considère qu’une hypothétique amende leur coûtera souvent moins cher que de respecter le droit du travail.
Certes, les procureur.es ont toujours théoriquement la possibilité de requalifier pénalement les infractions constatées, selon les pénalités prévues par le Code pénal[17. Lors des différentes rencontres parquet-inspection, les procureur.es expliquent là encore qu’il.les ne peuvent pas poursuivre au pénal (au sens du code du pénal), parce que le lien de cause à effet n’aurait pas été démontré, oubliant comme il se doit le lien de subordination patron.ne-salarié.e.]. De ce point de vue, l’épisode fameux du juge De charrette, qui en 1975 avait poursuivi un employeur pour homicide involontaire suite à un accident du travail, n’est que l’exception qui confirme la règle[18. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge De Charette établit que le responsable d’un accident est « celui qui a la compétence, les pouvoirs et l’autorité ». Sa décision d’ordonner la mise en détention provisoire d’un chef d’entreprise, M. Jean Chapron, pour homicide involontaire après un accident mortel du travail provoque une immense polémique qui ne fera que mettre en évidence de façon éclatante que la pénalité de droit commun n’est pas censée s’appliquer aux employeur.euses. Le garde des Sceaux lui-même, Jean Lecanuet, n’hésitera pas à prendre à partie le « petit juge » en le menaçant de poursuites disciplinaires.]. De telles requalifications sont rarissimes et la pénalité spécifique du travail joue bien son rôle : tenir les employeurs à l’abri de la pénalité de droit commun propre à la petite et moyenne délinquance sur les biens et les personnes.
Il ne s’agit pas ici de blâmer les magistrat.es en tant que tel.le.s, mais de tenter de comprendre par quels mécanismes nous pouvons aboutir à un tel fiasco judiciaire concernant un droit touchant quotidiennement 18 millions de salarié.es.
4. Tout est négociable ! Dérégulation à tous les étages
Si la justice est si peu sensible au droit du travail, c’est aussi parce que ce droit est délégitimé par le pouvoir politique lui-même. Le droit du travail est d’abord délégitimé par un discours idéologique récurrent, pour ne pas dire omniprésent : l’idée selon laquelle le droit du travail serait « trop rigide », « trop complexe », un « frein à l’emploi », à la « croissance », etc.[19. Selon le député socialiste Jean-Marie Le Guen les « rigidités du code du travail« , représenteraient « un redoutable tabou national » et « un puissant répulsif de l’emploi ». Cité par Pierre Joxe dans un entretien avec le journal Mediapart : http://www.mediapart.fr/journal/france/191214/pierre-joxe-je-suis-eberlue-par-cette-politique-qui-va-contre-notre-histoire] Ce discours pour le moins « compréhensif » est remarquable sur fond d’inflation du discours sécuritaire fustigeant depuis près de 20 ans un supposé « laxisme » judiciaire.
Un tel discours a pour conséquence de légitimer les employeur.euses en infraction, qui non seulement ne se vivent pas comme des délinquant.es, mais se sentent conforté.es à contester le bien-fondé des contrôles de l’inspection du travail. Fanny Doumayrou relevait que « la déréliction qui frappe ce corps de fonctionnaires s’explique en premier lieu par l’injonction paradoxale qui fonde sa mission : maintenir dans les clous du code du travail des chefs d’entreprise que les gouvernements encouragent par ailleurs à prendre leurs aises ; offrir un garde-fou contre l’exploitation, mais sans jamais recevoir de l’Etat, également garant de la liberté d’entreprendre, les moyens d’assurer une réelle protection des salarié.es. »[20. Fanny DOUMAYROU, Qui défendra les inspecteurs du travail ?, Monde Diplomatique, Décembre 2012.]
Mais surtout, ce discours s’est incarné depuis 30 ans en une succession de réformes visant à déréguler le droit du travail. Ce processus s’est accéléré ces 10 dernières années, avec l’extension continue des possibilités de déroger, par accord collectif, à la loi au code du travail dans un sens défavorable aux salarié.es. La loi a ainsi perdu de son importance au profit de la règle négociée. Parallèlement s’est opéré un renversement de la hiérarchie des normes au sein de la négociation collective avec primauté à l’accord d’entreprise, c’est-à-dire là où le rapport de force est le plus défavorable aux salarié.es. On observe ainsi un mouvement de fond vers un éclatement et une individualisation de la règle de droit, notamment sur des sujets aussi importants que la durée du travail, la rupture du contrat, la majoration des heures supplémentaires,…) Mouvement de fond qui a pour effet d’éclater le salariat et sa capacité de réponse collective.
Or, si l’on considère que le.la chômeur.se ou le.la salarié.e sont de simples cocontractant.e.s individuel.le.s, dont l’engagement personnel ne doit pas être soumis à des normes protectrices supérieures, le risque est grand que les salarié.es renoncent « librement », contre leurs propres intérêts, à un statut global créateur de droits.
Cette possibilité de renoncement « volontaire » au droit du travail commence à poindre de plus en plus. L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 ouvrait notamment la possibilité de « librement » renoncer au seuil minimal de 24 heures pour les temps partiels. Ce seuil minimal était pourtant une des seules avancées de cet accord. De même certaines dérogations au repos dominical sont désormais possibles sous réserve d’un hypothétique « volontariat » du.de la salarié.e[21. Article L.3132-25-4 du code du travail.].
Le projet de loi Macron propose quant à lui de revenir sur l’article 2064 du Code civil, qui écartait les contrats de travail des procédures conventionnelles de règlement des différends[22. Selon la formulation actuelle de l’article 2064 du Code civil « aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. ».]. En d’autres termes, une telle modification ouvre la voie à des accords sur des litiges relevant du contrat de travail, là où ceux-ci relevaient de la compétence exclusive des prud’hommes. Un tel renoncement « volontaire » au tribunal des prud’hommes permettrait donc un règlement à la baisse de tous les litiges, sans possibilité de recours.
Or, il faut rappeler sans cesse qu’en droit du travail il n’y a pas de volontariat, tout au plus peut-il y avoir une soumission volontaire. Comme le disait déjà Karl Marx dans Le Capital : « Le travailleur libre, qui se rend sur le marché libre pour y vendre sa peau, doit s’attendre à être tanné. » La relation salariale est ainsi une relation fondamentalement inégale ; le code du travail ne limite jamais qu’en partie l’arbitraire patronal.
L’application du droit du travail fonctionne désormais comme si ce droit dérogeait à la notion même de droit, c’est-à-dire une norme collective protectrice applicable indépendamment de la « volonté » supposée des parties. Mais un droit du travail en miettes, est-ce encore du droit, c’est-à-dire une base sûre permettant de faire valoir des droits ?
Force est de constater qu’en matière de droit du travail, les pouvoirs publics semblent donc désormais considérer que tout doit pouvoir se négocier, réalisant ainsi les vœux du patronat[23. « Nous préconisons une réforme de la Constitution afin de reconnaitre le droit à la négociation, et de permettre aux représentants des employeurs et des salariés de fixer les modalités d’application des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale », expliquait l’ancienne présidente du Medef Laurence Parisot aux Échos en 2006. Cité par Laura Raim dans http://www.regards.fr/web/article/la-loi-macron-ou-comment-revenir.] au nom de la tarte à la crème du « dialogue social », l’autre nom de la dérégulation généralisée en matière de droit social.
5. On peut toujours s’arranger… de la justice pénale à la négociation administrative
La dernière étape de ce processus de négociation et d’arrangement permanents vise à remplacer le droit pénal du travail par un jeu de négociation administrative des peines. C’est le projet initié en son temps par Michel Sapin, ancien ministre du travail, et qui trouve aujourd’hui à se réaliser dans le projet de loi Macron. De quoi s’agit-il ?
Tout simplement, de passer progressivement d’un système de sanctions pénales à un système de sanctions administratives. Au vu du bilan peu reluisant des suites pénales actuelles, le passage à un autre système de sanctions pourrait sembler séduisant. Mais passer d’un système de sanctions pénales à un système de sanctions administratives revient à sortir les employeurs des tribunaux correctionnels pour les ramener dans le jeu ouaté des négociation administratives entre gens de bonne compagnie sur la base d’un plaider-coupable. Exit l’audience publique devant un juge, remplacée par une discussion de marchands de tapis dans le bureau d’un hiérarque du ministère du travail.
Le symbole a son importance dès que l’on touche à la bourgeoisie, il n’est pas indifférent pour les employeur.euses de se voir ramené.es, pendant un temps, au rang de simples délinquant.es parmi d’autres, obligé.es de se justifier devant un tribunal correctionnel. Le passage à un système de sanctions administratives permettra d’éviter ce genre de désagréments. Les victimes et les syndicats ne pourront en revanche plus se porter partie civile sur une procédure administrative.
Cette contre-réforme s’inscrit dans un mouvement de fond de dépénalisation des délinquances complexes (fraudes fiscale et en matière de concurrence et de consommation, etc) par le passage à un système de négociation administrative[24. Concernant les impôts, on peut se reporter à l’article édifiant d’Alexis Spire paru dans le n° de février 2013 du Monde diplomatique, « Comment contourner l’impôt sans s’exiler ». Si des procédures pénales peuvent ponctuellement être engagées, le système de sanctions repose essentiellement sur la négociation administrative Celle-ci a pour particularité de moduler les possibilités en fonction de la classe sociale du contrevenant et du niveau d’infraction. En un mot le petit délinquant fiscal (non-paiement de la redevance TV par exemple) pourra au mieux négocier un étalement des paiements, là où en haut de l’échelle sociale, le grand délinquant pourra se payer le luxe de négocier le montant des amendes (notamment lorsqu’il s’agit de l’évaluation des patrimoines).]. Formellement les sanctions pénales demeurent possibles, concrètement la négociation de sanctions administratives prend le pas sur le droit pénal.
Autre point fondamental, ce pouvoir de sanction administrative appartiendra au.à la directeur.trice régional.e, le DIRECCTE[25. Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.], et non à l’inspecteur.trice du travail. L’enjeu est donc une véritable perte d’indépendance pour les inspecteur.trices du travail sur leurs propres procédures. Car les directeur.trices régionaux.nales, soumis.es aux ordres des préfets notamment concernant les politiques de l’emploi, n’ont aucune garantie d’indépendance statutaire, contrairement aux agent.es du corps de l’inspection. Il.les en seront d’autant plus sensibles au chantage à l’emploi que ne manqueront pas d’utiliser les employeur.euses en infraction dès qu’il.les seront mis.es en cause.
Conclusion
Nous avons commencé notre article en situant la notion de « justice de classe » dans la lignée de Foucault comme économie générale des illégalismes dans une stratégie globale de différenciation. « L’illégalisme des biens a été séparé de l’illégalisme des droits, constate Michel Foucault. Partage qui recouvre une opposition de classes, puisque, d’un côté, l’illégalisme qui sera le plus accessible aux classes populaires sera celui des biens – transfert violent des propriétés –; que, d’un autre, la bourgeoisie se réservera, elle, l’illégalisme des droits : la possibilité de tourner ses propres règlements et ses propres lois ».
De ce point de vue, l’exemple du droit du travail nous paraît remarquable, tant la différenciation s’incarne d’un bout à l’autre de la chaîne pénale. Moyens humains dérisoires de la « police du travail » qu’est l’inspection du travail, droit pénal dérogatoire par rapport au droit pénal propre aux illégalismes sur les biens et les personnes des classes populaires, suites pénales plus qu’aléatoires et projet de passer à un système de sanctions administratives négociées. La boucle de la différenciation visant à préserver le patronat de toute confusion avec la figure infâmante du délinquant, cette naturalisation de l’illégalisme des classes populaires, est ainsi constituée. Comme le note le sociologue Laurent Bonelli, « les fraudes, les opérations commerciales irrégulières, les évasions fiscales sont renvoyées vers des juridictions spéciales et des commissions d’arbitrage plus feutrées, où dominent les transactions, les accommodements, les amendes. »[26. Laurent BONELLI, Le récidiviste, voilà l’ennemi !, Le Monde diplomatique, août 2014.]
Passer des institutions pénales à l’entre-soi d’une négociation administrative, d’une publicité infâmante des débats à la privatisation d’une procédure, quelle plus remarquable incarnation d’une justice de classe là où il est question de droit du travail, c’est-à-dire, en dernier recours, de l’état du rapport de force entre travail et capital ?
Gilles Gourc
Voici un article de Gérard Lyon-Caen paru dans le Droit ouvrier de janvier 1951 qui pose un regard intéressant de notre point de vue — CNT — quant à la nature du droit du travail : à la fois la légalisation de l’exploitation capitaliste et protection des travailleurs contre cette même exploitation, car expression des rapports de force entre travailleurs et exploiteurs.
La réflexion de Gérard Lyon-Caen est à mettre en relation avec la conception que nous avons de notre mission d’agent de contrôle de l’inspection du travail au regard de notre éthique révolutionnaire et de notre rôle dans la lutte des classes.
En pdf : fondements-historiques-rationnels-droit-travail-géard-lyon-caen